Le 7 février 2021, un peu plus de 13 millions d’Equatoriens se sont rendus aux urnes pour choisir entre 16 candidats à la présidence de la République et élire 137 parlementaires et 5 députés andins. D’emblée, et sans contestation possible, l’économiste socialiste Andrés Arauz (Union pour l’espérance ; UNES), soutenu par l’ex-président et figure de la gauche latino-américaine Rafael Correa, a été déclaré vainqueur du premier tour avec 32,72 % des voix.
Annoncé prématurément de quatre manières différentes – un sondage « sortie des urnes », un comptage rapide, une conférence de presse, puis une annonce de résultats encore partiels –, sous l’égide du Conseil national électoral (CNE), le nom du candidat admis au second tour du 11 avril prochain a évolué au fil du temps, provoquant polémiques et confusion. Du fait d’un ballotage particulièrement serré, le banquier et ex-ministre néolibéral Guillermo Lasso (Créer des opportunités-Parti social chrétien ; CREO-PSC) a d’abord devancé le « candidat indigène écologiste de gauche » Yaku Pérez (Pachakutik ; PK), avant que celui-ci ne reprenne l’avantage, puis ne repasse en troisième position et se trouve ainsi éliminé. Quand, deux semaines plus tard, tomberont les résultats officiels (contestés par Pérez, mais définitivement confirmés quatre semaines plus tard), ils annonceront :
- Andrés Arauz (UNES) : 32,72% (3 033 753 voix)
- Guillermo Lasso (CREO-PSC) : 19,74% (1 830 045 voix)
- Yaku Pérez (PK) : 19,39 % (1 797 445 voix)
- Xavier Hervas (Gauche démocratique ; ID) : 15,98 %
Si l’on devait en rester là, on pourrait se livrer à une première analyse. Particulièrement significative est la victoire d’Andrés Arauz, tant une guerre sale a tenté d’éradiquer le « correisme » (courant lié à l’ex-président Correa) depuis l’arrivée au pouvoir en 2017 de Lenín Moreno. Vice-président de Correa de fin 2006 à 2013, censément élu pour poursuivre la « révolution citoyenne » de son prédécesseur, Moreno l’a trahi, ainsi que les électeurs du parti Alianza País (AP) [1], en reniant tous ses engagements, en co-gouvernant avec la droite et en persécutant ses anciens « amis ». Il a déjà un pied dans les poubelles de l’Equateur – en témoigne le résultat de Ximena Peña, qui représentait (plus ou moins) son courant lors du scrutin présidentiel (1,54 % des voix), et le fait que les décombres d’Alianza País (parti fondé par Correa et dominant pendant sa présidence) n’a pu faire élire aucun député. Tandis que Moreno se dispute le titre de « politicard le plus méprisable » (et le plus méprisé) d’Amérique latine avec un autre transfuge de la gauche, le secrétaire général de l’Organisations des Etats américains (OEA) Luis Almagro, le « correisme », avec son noyau dur, contre vents et marées, demeure la principale force politique et électorale du pays [2].
A un deuxième échelon, mais eux aussi au rang des gagnants, figurent Xavier Hervas et sa Gauche démocratique (GD) ainsi que, et surtout, Yaku Pérez et Pachakutik. Vieux parti social-démocrate (aujourd’hui centriste et furieusement anti-correiste), GD avait quasiment disparu de la circulation. Sa meilleure prestation remontait à 1988 quand il amena Rodrigo Borja au pouvoir. Sa renaissance remarquée doit beaucoup à son nouveau leader, Xavier Hervas, ingénieur, dirigeant d’entreprise, récemment entré en politique et particulièrement dynamique sur les réseaux sociaux.
Bras politique de la Confédération des nationalités indigènes d’Equateur (Conaie), Pachakutik avait certes et déjà obtenu 20 % des suffrages en soutenant, en 1996, le journaliste Freddy Ehlers à la présidentielle (finalement gagnée par Abdalá Bucaram), mais c’était en coalition avec d’autres organisations sociales, partis traditionnels de gauche et syndicats. C’est cette fois en solo qu’il affiche un score jamais atteint auparavant.
Outre Lenín Moreno, le scrutin fait deux grands vaincus : le néolibéralisme, représenté par Lasso, et… les instituts de sondage. En ne voyant surgir ni Hervas ni Yaku Pérez, très largement sous-estimés dans leurs enquêtes d’opinion, les instituts se sont une fois de plus ridiculisés. De leur côté, et bien qu’arrivant en seconde position, Lasso et sa coalition de droite CREO-Parti social chrétien font leur plus mauvais score des trente dernières années. Leur connivence avec la politique économique de Moreno (qui était en réalité la leur) et ses conséquences sociales – aggravées par la désastreuse gestion de la pandémie (plus de 15 000 morts pour une population de 17,4 millions d’habitants) – expliquent ce verdict. En tant qu’option, le néolibéralisme est très clairement rejeté par les Equatorien.
A eux trois, l’UNES, PK et GD, considérés comme de gauche ou de centre-gauche, représentent 68 % des suffrages exprimés. Sur le papier, on pourrait donc imaginer une alliance interdisant tout retour au pouvoir du parti de la « longue nuit néolibérale ». Sauf qu’il y a « gauche » et « gauche ». Sauf que, avec ses convergences, mais aussi ses incompatibilités, ses jeux d’influence, ses rivalités voire ses haines, l’affaire n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Car ce scrutin s’est déroulé dans une configuration très particulière. Un seul mot d’ordre a animé la campagne qui l’a précédé : « N’importe qui, n’importe comment, mais tout sauf Arauz » (et, sous-entendu, son « mentor » Correa).
Candidat de Pachakutik, Yaku Pérez s’est fait connaitre en tant que « défenseur du droit à l’eau, opposé à l’exploitation minière ». En ces temps de désordre climatique, un tel positionnement provoque légitimement intérêt et sympathie. A ce titre, Pérez s’est radicalement opposé à la politique « développementiste » de Correa. De cette confrontation, qui lui a valu quatre brèves incarcérations [3], Pérez a gardé une féroce détestation de l’ex-chef de l’Etat et de son courant politique. En 2017, alors que nul n’imaginait la trahison ultérieure de Lenín Moreno à l’égard de son prédécesseur, Pérez appellera à voter pour Lasso, déjà candidat, en déclarant : « Plutôt un banquier qu’un dictateur ! »
Quatre années plus tard, sa frustration devant la différence infime qui lui barre l’accès au second tour – 32 000 voix, 0,35 % des suffrages – est parfaitement compréhensible. Pour autant, l’autorise-t-elle, comme il l’a fait dès l’annonce des résultats, à dénoncer une fraude massive organisée par un supposé « pacte oligarchique » passé entre Lasso, son allié du PSC Jaime Nebot et… leur ennemi de toujours Correa ? A inventer une « main invisible qui, depuis la Belgique [où réside actuellement Correa] », interviendrait pour truquer le scrutin « car Yaku au second tour ne leur convient pas » ? De là à appeler la « population indigène » à prendre la rue pour « défendre la démocratie », il n’y a eu qu’un pas. Une attitude pour le moins troublante. Si, ces dernières années, le « grand air de la fraude » a été régulièrement et illégitimement employé pour contester le résultat d’une élection, c’est par la droite réactionnaire voire putschiste, au Venezuela, au Nicaragua, plus récemment en Bolivie (et même aux Etats-Unis !) [4].
Mus par la certitude qu’ils incarnent l’avant-garde éclairée de la démocratie, des défenseurs de la « diversité » et des protecteurs de l’environnement, d’aucuns ont pris partie pour un Pérez d’emblée « victimisé ». En témoigne l’appel de soutien publié sur Mediapart par quelques personnalités qui, bien souvent, après avoir porté l’aymara Evo Morales aux nues (quand il était à la mode), puis s’en être détournés (quand il était au sol), viennent de se trouver un nouveau « bon Indien à poncho » – à l’instar (pour la France) de Laurence Rossignol (Parti socialiste ; PS), David Cormand et Alain Lipietz (Europe Ecologie Les verts ; EELV), Sergio Coronado (EELV ou La France Insoumise, selon ses intérêts du moment), Pierre Salama (économiste) [5]…
Moins enclins à surfer sur l’air du temps, d’autres se montrent plus circonspects sur le positionnement réel de l’« Indigène écolo de gauche ». Quinquagénaire, avocat, le métis Carlos Ranulfo Pérez Guartambel ne s’est rebaptisé « Yaku » (« eau de la montagne » en quechua) que le 9 août 2017. Tout romantisme mis à part, on appelle cela une opération de marketing politique. Tout comme le fait de mener sa campagne électorale en vélo (comme Anne Hidalgo !). Des pratiques purement symboliques qui, à l’occasion, laissent deviner leurs limites. Quand, au cours de sa campagne, Arauz a annoncé que, en cas d’arrivée au pouvoir, il octroiera une allocation de 1 000 dollars à un million de familles en difficulté du fait de la crise et de la pandémie, l’ « éco-socialiste » s’est contenté d’une réaction fleurant bon le mépris de classe : « N’ayant jamais eu autant d’argent entre les mains, le plus probable est que certains vont tout dépenser en bières le jour même, et qu’il ne restera plus rien [6]. » Curieuse manière d’incarner une « autre gauche » et un supposé « renouveau ».
C’est donc dans un contexte plus global, et dans le temps long, qu’il convient, pour les comprendre, de replacer les événements qui amèneront au second tour du 11 avril prochain.
Rafael Correa
Après avoir assumé la présidence en 2007, l’économiste Rafael Correa va être réélu en 2013 avec 56 % des suffrages. Approuvée le 28 septembre 2008 par 64 % des électeurs, la Constitution dite de Montecristi introduit le concept autochtone à vocation universaliste du « Bien vivre » (« Buen vivir » en espagnol, « Sumak Kawsay » en quechua). Elle reconnaît la diversité culturelle et les différentes origines (traduites par le terme « plurinationalité »), le droit à une sécurité sociale universelle, l’interdiction des OGM, etc…
L’ancien modèle tremble sur ses bases. La Banque centrale perd son indépendance. En mai 2009, les banques se voient obligées à détenir 45 % de leurs actifs liquides dans le pays ; ce ratio passe à 60 % en 2012 et même 80 % en 2015. Dès novembre 2008, Quito a annoncé la suspension du remboursement de dettes jugées « illégitimes » et arrivant à échéance en 2012 et 2030 pour un montant total de 3,2 milliards de dollars. En prenant en compte les intérêts, le Trésor public économisera environ 7 milliards de dollars en rachetant ses dettes à 35 % de leur prix.
Le pouvoir investit massivement dans les infrastructures hydroélectriques et routières. Près de 10 000 kilomètres de routes ouvertes ou remises en état permettent d’accélérer les liaisons intérieures et de désenclaver certaines zones. Essentiellement axées sur l’éducation (4,3 % du PIB en 2016, contre 2,3 % en 2006) et la santé (2,4 % en 2016 contre 1,1 % en 2006), les dépenses sociales augmentent elles aussi fortement – de 4,3 % du PIB en 2006 à 8,6 % en 2016 [7]. Secrétaire générale de la Commission économique pour l’Amérique latine (Cepal) de l’Organisation des Nations unies, Alicia Bárcena cite régulièrement l’Equateur comme un exemple pour l’Amérique latine.
Toute tentative de modifier les habitudes politiques et sociales soulève en général des résistances assez considérables. Les classes dominantes et l’élite économique n’accepteront jamais les changements structurels imposés par Correa. Exaspérés par cette « Internationale progressiste et révolutionnaire au niveau continental », comme la définit le vice-président bolivien Álvaro García Linera, les Etats-Unis font chorus. D’autant que le chef de l’Etat équatorien défraie régulièrement la chronique en raison de ses méthodes radicales et de ses opinions tranchées. A la meute des médias de droite qui l’étrillent, le combattent, diffusent une information et une propagande à sens unique, l’accusent de tout et n’importe quoi, il rend coup pour coup. En 2013, la nouvelle Loi organique de communication définit cette activité comme de « service public » ; vise à redistribuer l’espace médiatique (un tiers du spectre radioélectrique pour le secteur privé, un tiers pour le secteur public et un tiers pour le secteur à but non lucratif) ; interdit qu’un établissement financier détienne plus de 6 % du capital d’un organe de presse [8]… L’horreur absolue !
De l’autre bord du spectre politique monte une contestation bruyante, à défaut d’être massive. Le pays profite d’un sous-sol extrêmement riche en pétrole, en minerais, en gaz – et donc en revenus pour financer les politiques sociales dont profite la majorité de la population. Au nom d’un « anti-extractivisme » du type « tout ou rien », Correa se voit systématiquement cloué au pilori. Rejoignant et confortant l’opposition de droite, ces secteurs au sein desquels se trouve la Conaie l’accusent « de trahison, d’autoritarisme et d’hyper-présidentialisme ; ils revendiquent être la gauche authentique et représenter les mouvements sociaux », rappelle l’historien Juan Paz y Miño Cepeda.
Définie par l’ex-président comme « la tourmente parfaite, une brutale chute des cours du pétrole (de 100 à 22 dollars), l’appréciation du dollar (qui en 2000 a remplacé le « sucre », l’historique devise nationale), la dévaluation des monnaies de la Colombie et du Pérou voisins (rendant leurs produits plus attractifs), les fortes amendes infligées à l’Equateur par un arbitrage international attribuant un milliard de dollars à la compagnie pétrolière américaine Oxy, plus, pour couronner le tout, le meurtrier tremblement de terre du 16 avril 2016 dans la région de Manabí (668 morts, 16 000 blessés, plus de 80 000 sinistrés, 3,5 milliards de dommages matériels), provoqueront, de 2015 à 2017, de très sérieuses difficultés économiques. Et pourtant…
La partie ne se comprend que par rapport au tout. La victoire d’Arauz au premier tour de la présidentielle de 2021 a un fondement. Il a été vice-ministre de la Planification, ministre de la Connaissance et du Talent Humain et directeur de la Banque centrale sous le gouvernement de Correa (un profil assez similaire à celui de Luis Arce, récemment élu, en disciple d’Evo Morales, en Bolivie). Pendant les dix années de cette présidence, l’Equateur a connu une période inhabituelle de croissance et de stabilité macroéconomique. Dans un pays souvent considéré comme « ingouvernable » (sept présidents en dix ans avant Correa), cette embellie a permis une diminution significative des inégalités et d’une pauvreté qui, de 37,6 %, est passée à 22,5 %. Le salaire minimum a bondi de 170 dollars (2007) à 360 dollars (2015). Les Equatoriens ont de la mémoire – surtout les 1,9 millions d’entre eux sortis de la pauvreté grâce au « socialisme du XXIe siècle ». Avec ses qualités et ses défauts, Correa a profondément transformé le pays.
La Conaie et Pachakutik
Selon l’Institut équatorien de statistique et de recensement (INEC), et sur la base de l’« auto-déclaration », 7 % des Equatoriens se considéraient indigènes en 2001. L’Organisation des Nations Unies avance pour sa part un chiffre de 43 %. Des estimations plus raisonnables estiment la proportion des autochtones à environ 25 %. Au-delà des évaluations plus ou moins approximatives, ces populations historiquement marginalisées – Quechua, Awa, Shuar, Ashuar, etc. – constituent, sur la scène politique équatorienne, depuis la fin du XXe siècle, des acteurs de tout premier plan.
Influence des courants marxistes, puis de la théologie de la libération, émergence d’élites ayant eu l’accès à l’éducation : la Confédération des nationalités indigènes d’Equateur (Conaie) apparaît en 1986. En juillet 1990, dans la perspective des célébrations prévues deux ans plus tard par l’Espagne pour commémorer le cinq-centième anniversaire de la funeste « découverte de l’Amérique », c’est à Quito que se tient la première rencontre continentale des peuples indigènes, dans le cadre de la campagne « Cinq cents ans de résistance indienne » (qui deviendra ultérieurement « Cinq cents ans de résistance indienne, noire et populaire »). « Nous voulons cohabiter, nous confie à l’époque un dirigeant autochtone équatorien, mais en nous faisant respecter. Et en ceci nous différons de quelques camarades indigènes qui proposent un regroupement entre seuls Indiens. Tous les secteurs populaires doivent faire une proposition commune sur la terre, les droits de l’homme, l’anti-impérialisme... Nous sommes Indiens, les autres sont métis, mais la lutte poursuit le même objectif. Aussi, nous devons unir nos efforts, tout en respectant nos spécificités [9]. »
Cette même année 1990, puis en 1994 du fait d’une inique nouvelle loi agraire, c’est effectivement sur la base de revendications identitaires mais aussi de classe et anti-impérialistes que la Conaie prend la tête de deux gigantesques soulèvements, paralyse une grande partie du territoire national, isole les villes et commotionne le pays. Cette montée en puissance de la Conaie, devenue la plus importante force sociale du pays, débouche sur une très grande autonomie par rapport aux mouvements, qu’ils soient de gauche, d’Eglises, d’organisations non gouvernementales (ONG) ou de partis politiques. En 1995, dans la perspective de l’élection présidentielle de l’année suivante, la Conaie se dote d’un bras politique, le Mouvement de l’unité plurinational Pachakutik-Nouveau pays (MUPP-NP, communément connu sous le nom de Pachakutik). Malgré l’échec de Freddy Ehlers, soutenu à la présidentielle dans le cadre d’une coalition, Luis Macas, président de la Conaie depuis 1990, devient le premier député indigène élu au Parlement.
Au cours des années suivantes la Conaie participe activement au renversement des présidents Abdalá Bucaram (1997) et Jamil Mahuad (2000), sauveteur des banques et fossoyeur du peuple lors d’une crise majeure qui poussera 2 millions d’Equatoriens à l’émigration. Crise dont, entre parenthèses, profitera largement à l’époque le banquier Guillermo Lasso. Le renversement de Mahuad s’est mené en alliance avec un secteur militaire emmené par le colonel Lucio Gutiérrez – ce qui en fait objectivement un coup d’Etat. Lorsque, en 2000, Gutiérrez est élu à la présidence avec l’appui de Pachakutik et des partis de gauche, quatre dirigeants indigènes entrent au gouvernement, dont Luis Macas à l’Agriculture et Nina Pacari aux Affaires étrangères. Une première dans l’Histoire équatorienne, une intrusion spectaculaire au plus haut sommet de l’Etat. Mais qui se termine mal. Elu sur un discours « de gauche », Gutiérrez fait du Moreno avant Moreno. Il trahit ses promesses, engage une politique néolibérale, se vend aux Etats-Unis de George W. Bush – leur accordant entre autres une base militaire à Manta.
Les ministres indigènes démissionnent, la Conaie rompt les ponts, mais peut-être trop tardivement… Sa crédibilité s’en trouve sérieusement entamée. Qui plus est, elle n’a aucun rôle en 2005 dans le renversement de Gutiérrez par une révolte des secteurs populaires et de la classe moyenne autoconvoqués – les « forajidos » (« hors-la-loi »).
Echaudés et meurtris par cet épisode, les dirigeants se replient sur une ligne « communautaire ». Lors de l’élection présidentielle de novembre 2006, Pachakutik choisit de se présenter contre l’économiste de gauche Correa plutôt que de forger une alliance avec lui. Et là a lieu un événement qui se reproduira et qu’on se gardera d’oublier dans la perspective du second tour de l’élection présidentielle d’avril prochain : la base indigène ne suit pas les directives de ses dirigeants. Alors que Correa est élu avec 54,92 % des suffrages, Luis Macas, pour Pachakutik, ne recueille que 2,10 % des voix.
Dès lors, le bras politique de la Conaie n’a plus rien à voir avec le Pachakutik des origines. L’un de ses ex-dirigeants, Fausto Rangles, dénoncera son financement par des ONG, comme la Fondation Pacha Mama, elles-mêmes arrosées par la New Endowment for Democracy (NED) – le bras financier destiné à canaliser les fonds du Département d’Etat américain vers les oppositions, démocratiques ou non, aux forces et aux gouvernement de gauche [10]. PK apparaît également parmi les destinataires de fonds du National Democratic Institute for International Affairs, un « think tank » étatsunien idéologiquement lié au Parti démocrate et qui, dans le cadre de la NED, prétend promouvoir dans le monde la « démocratie made in Washington ».
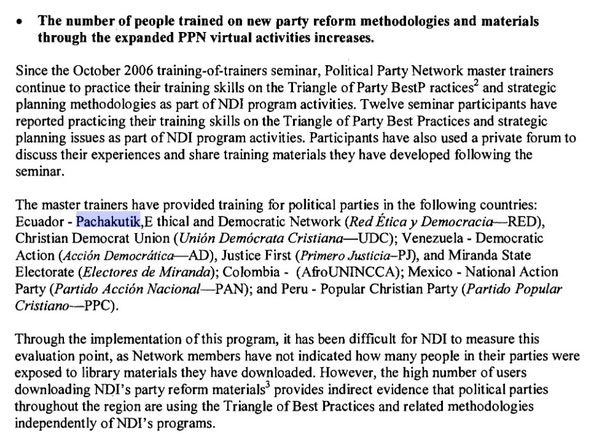
- National Democratic Institute (NDI), 2007
« Extractivisme », « autoritarisme » : Correa est devenu l’ennemi principal d’une mouvance apparentée à l’extrême gauche. Le 30 septembre 2010, pour d’autres raisons, des centaines de policiers se soulèvent dans les principales villes équatoriennes (comme en Bolivie, neuf ans plus tard, pour renverser Evo Morales !), prennent le contrôle de l’Assemblée nationale, tandis que des effectifs des Forces armées occupent les aéroports de Quito et de Guayaquil, le cœur économique du pays. Se rendant immédiatement dans la caserne du Régiment 1 de Quito pour parler aux insurgés, le chef de l’Etat doit se replier dans l’Hôpital militaire métropolitain, où il se retrouve séquestré par les policiers qui encerclent l’établissement. Par la voix de son président Marlon Santi, la Conaie publie un communiqué ambigu renvoyant dos à dos le chef de l’Etat et les factieux, et appelant « à l’unité pour une démocratie plurinationale des peuples ». Les leaders de Pachakutik se montrent pour leur part beaucoup plus clairs. Tandis que Lourdes Tibán applaudit les policiers et militaires séditieux en précisant « C’est l’heure ! », le chef du bloc Pachakutik à l’Assemblée nationale, Cléver Jiménez, convoque « le mouvement indigène et les mouvements sociaux à constituer un seul front national pour exiger le départ du président Correa ». Le coup d’Etat échoue, mais, cette fois, la guerre ouverte est déclarée. Et pourtant (bis)…
Quand, en 2013, une supposée Unité plurinationale des gauches, rassemblée autour de Pachakutik et avec comme tête de liste Alberto Acosta se présente contre Correa, elle ne recueille, une fois encore, que 3,26 % des suffrages.
Même scénario en 2017, dans des conditions que la « tourmente parfaite » a pourtant rendues plus difficiles pour le pouvoir. D’autant que Correa ne se représente pas et lance dans l’arène son ex-vice-président Lenín Moreno, moins populaire et charismatique que lui. Dans la perspective du scrutin, trois dirigeants de Pachakutik, féroces opposants à Correa, annoncent leur candidature à une primaire : Lourdes Tibán (députée de Cotopaxi), Salvador Quishpe (préfet de la province de Zamora Chinchipe) et Carlos Pérez Guartambel (pas encore liquéfié en Yaku), président de la Confédération des peuples de la nationalité Quechua (Ecuarunari). La proposition ne convainc guère et PK opte finalement pour un attelage embarquant à son bord la vieille gauche dite marxiste, une nébuleuse de « mouvements sociaux », des dirigeants indigènes, la Gauche démocratique, le tout emmené par l’ex-général puis maire de Quito Paco Moncayo. Fichant une paix royale à la droite et à l’extrême droite, cette « izquierdosidad » réserve ses coups au « correisme » et à Alianza País (AP). La stratégie ne se révèle guère payante. Alors que Moreno arrive en tête (39,36 %) et devance d’un million de voix Guillermo Lasso (28,11 %), la supposée « vaste, unique et authentique gauche » devra se contenter de 6,72 %.
De l’entracte précédant le second tour de cette élection date la fameuse apostrophe de Carlos Pérez Guartambel : « Plutôt un banquier qu’un dictateur ! » Moins surprenante qu’il n’y paraît. Car, dans ce registre, l’« écolo-progressiste » s’est déjà fait remarquer. Après qu’en Argentine la droite soit revenue au pouvoir en la personne de Mauricio Macri, survient en 2016, au Brésil, le coup d’Etat juridico-parlementaire qui renverse Dilma Roussef. Enthousiaste, Pérez tweete : « La #Corruption a achevé le gouvernement de Dilma et Cristina [Kirchner] ; il ne manque maintenant que tombent @MashiRafael [Correa] et [Nicolás] Maduro. C’est seulement une question de temps. »
Ce virage à droite contre-nature d’un responsable politique ayant perdu tout sens commun ne fait pas l’unanimité à la base. Dans la perspective du duel Moreno - Lasso, le Conseil élargi d’Ecuarunari désavoue Pérez en déclarant par la bouche d’un de ses principaux dirigeants, Humberto Cholango : « Il doit être clair pour tous qu’Ecuarunari n’appuie pas le banquier. »
Moyennant quoi, Moreno gagne au second tour, le 2 avril, avec 51,1 % des voix. AP s’assure la majorité à l’Assemblée en y faisant élire soixante-quatorze députés sur cent trente-sept et parachève cette victoire en remportant le référendum voulu par Correa sur l’interdiction faite aux fonctionnaires et aux élus de détenir des avoirs dans un paradis fiscal (54,97 % de « oui »).
La #Corrupción acabó al gob d Dilma y Cristina ; ahora falta q caigan @MashiRafael y Maduro. Solo es cuestión d tiempo https://t.co/6JPpgBicZM
— Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) November 15, 2016
Lenín Boltaire Moreno Garcés
Elu, Moreno s’est déclaré « président de tous », a remercié « de tout cœur » un Rafael Correa debout à ses côtés et visiblement ému. A la stupéfaction générale, le nouveau chef de l’Etat entre en guerre avec son prédécesseur dès sa prise de fonctions. En octobre 2017, Moreno effectue un voyage officiel au Pérou. Accusés de corruption et de blanchiment d’argent, deux anciens présidents de ce pays, Alejandro Toledo et Ollanta Humala sont inculpés. Humala a été placé en détention provisoire, Toledo est en cavale aux Etats-Unis. L’un de leurs prédécesseurs, Alberto Fujimori, purge une peine de 25 ans pour violations des droits humains.Au Brésil, Luis Inacio Lula da Silva vient d’être condamné à neuf ans d’incarcération par celui qui portera Jair Bolsonaro au pouvoir, le juge Sergio Moro. « En Equateur il n’y a pas d’ex-présidents en prison, mais nous ne perdons pas espoir », lâche un Moreno sibyllin, provoquant l’étonnement. En Espagne, fin juillet 2018, il traite publiquement Correa de « caïd de quartier » (« matón de barrio »).
Dès le 25 août 2017, conscients de la dérive, les ministres et cadres de la « révolution citoyenne »Ricardo Patiño, Paola Pabón et Virgilio Hernández ont démissionné du gouvernement. Le 31 octobre, la direction nationale d’Alianza País décide à l’unanimité de la destitution de Moreno du poste de président du mouvement et indique que l’ancien ministre des Affaires étrangères Patiño assumera cette fonction. Une intervention de la justice confisque le parti et le place sous le contrôle des proches de Moreno. Des soixante-douze députés d’AP, quarante-deux ne sont pas des maniaques de la loyauté : reniant sans vergogne Correa et leurs « amis » d’hier, ils accompagnent le félon dans sa restauration conservatrice et sa Très Sainte Inquisition.
Il n’a fallu que soixante-dix jours à Jorge Glas, vice-président élu sur le ticket de Moreno, pour prendre verbalement ses distances. Moreno le suspend de ses fonctions et l’accuse de corruption. Croyant en l’impartialité des juges, Glas demande à l’Assemblée de lever son immunité pour affronter la justice – ce qui sera fait. Au terme d’un procès plus que douteux, sans preuves irréfutables, il sera condamné à six, puis huit années de prison.
Persécutés, les députés de la révolution citoyenne Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri et Luis Fernando Molina doivent s’exiler au Mexique. Mais la cible « numéro un » demeure Correa. Depuis qu’il a quitté le pouvoir, il vit en Belgique (non parce qu’il a fui l’Equateur, mais parce que son épouse Anne Malherbe est originaire de ce pays). Bien lui en a pris. Moreno veut sa peau. Correa, c’est Al Capone et Ben Laden réunis, mais en plus dangereux ! Sous les prétextes les plus divers, le bureau du procureur va diligenter trente-huit enquêtes contre lui : dix pour détournement de fonds, huit pour trafic d’influence, trois pour fraude procédurale, deux pour trahison, une pour fraude fiscale, vol, tentative de meurtre, meurtre, falsification de preuves, incitation, corruption, crime organisé, falsification de documents publics... « Trente-huit procédures pénales, fermeture de comptes, suspension de la pension à vie, saisie des avoirs.... Vous souvenez-vous d’une persécution aussi brutale ? », ironisera l’ex-chef de l’Etat, sur Twitter, fin décembre 2020.
Volière de perroquets pleins de morgue, les mercenaires médiatiques – El Universo, El Comercio, El Telégrafo, Teleamazonas, Ecuavisa, etc. – se régalent. Apportent leur pierre à l’édifice. Créent une réalité alternative. Puis, au nom sans doute du droit à la désinformation, deviennent curieusement silencieux quand émerge un scandale impliquant Moreno lui même, son épouse Rocío González, son frère Edwin Moreno Garcés, sa belle-sœur Guisella González, l’un de ses amis intimes, Xavier Macías Carmignani. Une sombre histoire de pots de vin faisant passer 18 millions de dollars d’un « compte 100-4-1071378 » ouvert à la Balboa Bank, au Panamá, vers une entreprise offshore enregistrée au Belize, l’INA Investment Corporation – INA étant l’acronyme des prénoms IrINA, KarINA, CristiINA, des trois filles de Moreno.
Préalablement, les médias du service public – Ecuador TV, Radio Pública, Agencia Andes, El Tiempo, El Telégrafo – ont été fermés ou débarrassés de leurs cadres et journalistes dérangeants. Hernán Ramos s’est vu confier la direction de leur ligne éditoriale. C’est l’ex-directeur général de l’un des quotidiens équatoriens les plus à droite, El Comercio.
Dans ce même secteur public, 160 000 travailleurs reçoivent leur lettre de licenciement. Le budget de l’éducation supérieure perd 145 millions d’euros en 2019. Le programme des bourses est rogné. Des hôpitaux ferment, le système de santé se dégrade – la crise du Covid-19 le confirmera amplement. Ministre de l’Intérieur, María Paula Romo ne cache même pas que le pouvoir gouverne avec la droite dans le cadre d’un Accord national impliquant vingt-et-une organisations politiques : « Ce n’est pas qu’il y ait un co-gouvernement, c’est très simple. Il y a un accord, le mouvement gouvernemental a ses alliés et, même avec les mouvements d’opposition comme CREO ou le Parti social chrétien, nous avons des points communs (…) quelques points minimums de consensus, la bonne foi et la volonté de travailler [11]. »
Surfant sur la vague de propagande qui assimile sans nuances « correisme » et « corruption », le pouvoir a organisé en toute hâte, en février 2018, une consultation populaire. Qu’elle n’ait pas respecté l’obligation de consulter la Cour constitutionnelle et ait contourné les normes prévues (dans son article 104) par la Constitution, n’a pas empêché Ecuarunari et son leader Yaku Pérez d’appuyer avec enthousiasme son organisation. Parmi les sept questions posées à l’électorat, cinq concernent des projets de réforme constitutionnelle destinés, sans le dire, à « dé-Correiser » l’Etat, deux se présentent sous la forme d’une consultation populaire sur des thèmes chers aux « mouvements sociaux » [12]. La manœuvre réussit. Le « correisme » subit sa première défaite à une consultation électorale en onze années. A des degrés divers de pourcentage, un « oui » répond aux sept questions, avec deux conséquences majeures : l’interdiction de la « réélection indéfinie » (introduite dans la Constitution en 2015) ferme la porte à une potentielle candidature de Correa à la présidentielle de 2021 ; l’extinction des mandats des membres du Conseil de participation citoyenne et de contrôle social (CPCCS) démantèle l’organe indépendant chargé de la désignation des plus hautes autorités des entités publiques – défenseur du Peuple, procureur général, contrôleur général de l’Etat (à la tête de la Contraloría – sorte d’inspection des services), membres du Conseil national électoral (CNE) et du Tribunal de contentieux électoral (TCE), Conseil de la magistrature, etc.
L’Assemblée ayant nommé d’autorité un affidé, Julio César Trujillo, ainsi que six conseillers, à la tête d’un Conseil de participation citoyenne et de contrôle social transitoire (CPCCS-T), c’est par cette entité, qui n’a plus rien d’indépendante, que sera nommée procureure générale de la République, le 1er avril 2019, une certaine Diana Salazar. Malgré un médiocre 10/20 à l’examen écrit, celle-ci est arrivée première avec une moyenne de 88,17/100 grâce à de tout à fait exceptionnels 30/30 octroyés par trois jurés sur six à l’épreuve orale. La performance lui vaudra le sobriquet de « Procureure 10/20 » (pour la note obtenue à l’écrit).
Le 8 mai, le même CPCCS-T ratifie Pablo Céli au poste de Contrôleur général de l’Etat alors que celui-ci s’est emparé à la hussarde et dans l’illégalité la plus totale de l’institution. Le reste des décisions du Conseil est à l’avenant.
Par définition, le transitoire ne peut durer. Un nouveau CPCCS devra être élu. Craignant que certains de ses nouveaux membres ne soient issus de l’abominable « correisme », aucun des candidats ne devra appartenir, militer ou être lié à… un parti politique. Absurde, antidémocratique, mais pas suffisant ! Il semblerait que « la bête » bouge encore. Lorsque les postulants au futur Conseil se dévoilent, d’aucuns ne correspondent pas au profil désiré. Certains, dans leurs propositions, envisagent même que l’institution à venir puisse revenir sur les décisions et les nominations douteuses effectuées par le Conseil transitoire aux ordres de Trujillo. La panique s’empare de Carondelet (le palais présidentiel). Au terme d’une réunion entre Moreno, le contrôleur illégitime Pablo Céli et Trujillo, ce dernier lance une bruyante campagne réclamant que le CCPCS disparaisse définitivement. Trop tard pour empêcher, malgré une demande d’ « inconstitutionnalité » présentée devant la Cour adhoc, l’élection de ses membres, qui aura lieu le 24 mars 2019. Jour où, comble de malheur, lors d’élections locales, le « correisme », bien que dépouillé de son parti Alianza País, remporte les préfectures de Manabí (Leonado Orlando) et Pichincha (Paola Pabón), deux des trois provinces les plus peuplées du pays [13].
Une contre-révolution digne de ce nom doit complaire à 100 % à Washington. En ce sens, Donald Trump ne sera pas déçu. En août 2018, l’Equateur se retire de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA) [14] avant d’incorporer le mois suivant le Groupe de Lima, mortellement hostile au Venezuela de Nicolás Maduro [15]. « Nous sommes sur le point de sortir de l’abîme dans lequel ce socialisme mal nommé du XXIe siècle nous avait placés », déclare Moreno en mars 2019 en recevant le tout récent « président autoproclamé » vénézuélien Juan Guaido. Un mois plus tard, il déchoit Julian Assange de sa citoyenneté équatorienne. Elle lui avait été accordée en 2017 dans le but d’obtenir sa liberté sous couverture diplomatique. Moreno livre misérablement le journaliste à la police britannique, autorisée à investir les locaux de l’ambassade équatorienne à Londres.
Le 17 septembre, rejoignant les gouvernements de la droite continentale – Argentine, Brésil, Colombie, Chili, Pérou et Paraguay –, l’Assemblée nationale équatorienne ratifie le retrait du pays de l’Union des Nations sud-américaines (Unasur), portant un coup mortel à une intégration qui eut été fort utile, quelques mois plus tard, pour coordonner la lutte contre la pandémie. Pour ajouter l’obscénité à la bêtise, Moreno ordonne le déboulonnage de la statue de l’ex-président argentin de centre gauche Nestor Kirchner, qui trône à l’entrée du siège de l’Organisation, dans les environs de Quito et, à la mi-novembre, ordonne le départ de quatre-cents médecins cubains, souvent détachés dans des zones géographiques défavorisées, en vertu d’un accord passé avec La Havane, du temps de la « révolution citoyenne ».
Toutes les factions de l’anti-« correisme » frétillent de plaisir. Quel punch, mesdames et messieurs ! Elles se montreront moins exubérantes au mois d’avril suivant, quand, dans un chaos dantesque et faute d’une campagne de soins adaptée, les rues de Guayaquil, la deuxième ville du pays, se couvriront de dizaines de cadavres abandonnés sur les trottoirs, souvent emballés dans un film plastique pour éviter l’odeur de putréfaction.
En juin 2019, les Equatoriens ont appris l’autorisation donnée aux forces armées étasuniennes d’utiliser les Iles Galápagos comme porte-avions en agrandissant leur aéroport. Il s’agit d’une zone à la biodiversité unique, très fragile, classée « Patrimoine naturel de l’Humanité » par l’Unesco. Le silence de Carlos « Yaku Pérez » est alors assourdissant. Manifestement, le thème de l’écologie n’a rien d’une priorité quand (26 juin 2019), récemment élu gouverneur de l’Azuay, il reçoit, tout sourire, Michael J. Fitzpatrick, l’ambassadeur des Etats-Unis. Pas plus de réaction en novembre : Moreno appuie alors le rapport de l’OEA qui récuse la victoire d’Evo Morales à la présidentielle bolivienne en l’accusant de fraude, situation qui débouche sur un coup d’Etat. Et pour cause… Le 27 mai 2017, le métis Pérez s’était fendu d’un Tweet méprisant à l’égard de l’aymara, chef de l’Etat avec succès depuis dix ans : « Encyclopédique son ignorance - Evo est biologiquement indigène, mais sur le plan identitaire il s’est blanchi colonisé, il ne sent pas ou ne comprend pas la cosmovision indienne ».
Pour ne pas être en reste, la franco-brésilienne Manuela Picq, compagne de Yaku – ou ex-compagne, ou future ex-compagne (consulter la presse « people » pour connaître l’évolution de la situation) – se fendra d’un Tweet crapuleux le 11 novembre 2019, en plein coup d’Etat contre Evo et le Mouvement vers le socialisme (MAS) : « Des sœurs des bases indigènes en #Bolivie dénoncent une violence massive des groupes du #MAS – non seulement des maisons d’opposition brûlées, il y a en plus un réseau et des violations dans la rue. On craint qu’Evo ne soit en train de déclencher une guerre civile avec ses milices. » La déclaration tombe à Picq pour appuyer la « suprématiste blanche » Janine Añez. Le même jour, en Bolivie, celle-ci exige que les forces armées sortent pour réprimer les « hordes criminelles qui détruisent La Paz », faisant allusion aux humbles Boliviens des milieux indigènes et populaires qui protestent dans les rues contre le coup d’Etat. Quelques jours plus tard, ce ne sont pas les « milices d’Evo » mais le gouvernement putschiste d’Añez qui réprimera dans le sang les manifestations populaires et indigènes, faisant de l’ordre de trente-cinq morts lors des massacres de Senkata, Sacaba et Yapacaní.
Y a quienes se entregaron a la derecha oligarquica del banquero Lasso cómo lo llamaría ? Tiban, Quizhpe, Pérez y aliados ....
— Manuel Buñay Yunga (@manuelitoby) May 27, 2017
Hermanas de las bases indígenas en #Bolívia denuncian violencia masiva por grupos del #MAS - no solo casas de oposición quemadas, hay más red e violaciones en las calles. Se teme que Evo esté armando una guerra civil con sus milicias
— Manuela Picq (@manuelapicq) November 11, 2019
Le soulèvement d’octobre 2019
Le 1er octobre 2019, le président Moreno annonce une série de mesures économiques qu’il entend appliquer dans le cadre d’un prêt de 4,2 milliards de dollars du Fonds monétaire international (FMI). Entérinant la fin des subventions, le décret 883 fait passer le prix de l’essence de 1,85 dollars par gallon (3,8 litres environ) à 2,30 $, tandis que le diesel grimpe de 1,08 $ à 2,27 $ – une hausse de plus de 120 %. Avec autant de cœur qu’un tiroir-caisse, le pouvoir notifie que les fonctionnaires verront leurs congés passer de 30 jours à 15 jours par an ; que les travailleurs occasionnels seront réembauchés avec une baisse de 20 % de leur salaire ; que les fonctionnaires se verront dépouiller d’un jour de leur rémunération mensuelle. En revanche, l’Etat procédera à un remboursement des taxes aux exportateurs « pour revigorer l’économie » ; à une réduction de moitié de la taxe sur les sorties de devises pour les matières premières, les intrants et les biens d’équipement ; à une simplification et réduction de l’impôt sur le revenu pour le secteur de la banane ; à une série de privatisations ; etc.
Plus que le reste, l’augmentation des prix des carburants provoque un soulèvement populaire. Au secteur des transports se joignent rapidement le Front unitaire des travailleurs (FUT), les groupes liés au Mouvement révolution citoyenne (MRC) de Correa, le Front populaire, les syndicats enseignants, les fédérations étudiantes et, en tout premier lieu, apportant le plus gros des troupes, la Conaie. C’est elle qui – en coalition avec le Conseil des peuples et organisations indigènes évangéliques (Feine) et la Confédération nationale des organisations paysannes, indigènes et noires (Fenocín) – va jouer un rôle prépondérant.
On se gardera d’ironiser ici sur un mouvement indigène présenté de façon caricaturale comme unanimement « anti-extractiviste », en particulier s’agissant du pétrole, mais se battant en première ligne contre une hausse du prix de l’essence et du diésel. Somme toute, pour les tenants d’un idéal pur, protégé des contradictions, une telle mesure irait plutôt dans le bon sens pour réduire l’extraction de l’or noir (bien que là n’ait pas été l’objectif de Moreno) ! Avec pour conséquence une augmentation de 123 % du jour au lendemain, la fin des subventions a dans un pays comme l’Equateur un effet dévastateur puisque touchant non seulement les automobiles individuelles, mais aussi les transports public et collectifs et donc les denrées alimentaires, qui subissent une hausse de prix généralisée. Le fonctionnement des sociétés déborde sans cesse les cadres dans lesquels les théories simplistes prétendent l’enfermer : l’« Indigène » idéal des ONG et des journalistes est peut-être « anti-extractiviste », mais il n’est pas étranger aux contingences de la vie réelle non plus.
Les protestations ont débuté le 2 octobre. Une semaine plus tard, la Conaie appelle à la grève générale. Le gouvernement décrète l’état d’exception et lance dans la rue les forces de sécurité. Entretemps, il a réussi à acheter la Fédération des coopératives de transport public de passagers (Fenacotip). Celle-ci suspend le mouvement après avoir obtenu la libération de plusieurs dirigeants détenus pendant les manifestations et des mesures compensatoires – dont une hausse des tarifs, de manière à répercuter les coûts supplémentaires sur… les usagers.
Tous ne se laissent pas acheter. Devant la montée en puissance de la rébellion, Moreno quitte la capitale Quito et installe son gouvernement à Guyaquil, ville côtière où les organisations autochtones sont peu présentes. Avec à leur tête Jaime Vargas et Leonidas Iza, les indigènes de la Conaie bousculent Quito, investie le 12 octobre quand des milliers d’habitants de la classe moyenne se joignent aux manifestations. Sous l’autorité de la ministre de l’Intérieur María Paula Romo, une « féministe » et opposante « de gauche » à Correa, la répression s’abat dans tout le pays. Elle laissera derrière elle onze morts, quelque 1 500 blessés et plus de 1 200 détenus.
Comme toujours tout au long de son histoire, la Conaie n’a rien d’un bloc monolithique. Aux combattifs Vargas et Iza, qui réclament le retrait pur et simple du « paquetazo » avant un quelconque début de négociation, s’oppose un secteur plus conciliateur. C’est vers lui que se tourne Moreno. Ignorant les autres porte-paroles du mouvement indigène, il favorise l’ex-préfet de Morona (et « anti-correiste » absolu) Salvador Quishpe. Sur les réseaux sociaux, celui-ci absous le chef de l’Etat : la répression est due aux pressions de secteurs de la droite qui ne le laissent pas « se réconcilier avec le mouvement indigène ». Après avoir dénoncé la violence des… manifestants, Quishpe et son cercle rapproché, parmi lequel Lourdes Tibán, élaborent un document remis aux médiateurs des Nations unies dans le but d’ouvrir un dialogue.
Sous l’égide de l’ONU et de la Conférence épiscopale, les pourparlers débouchent le 13 octobre, après onze jours de confrontation, sur une dérogation du fameux décret 883 concernant le prix des carburants. Mais rien de plus. Les autres secteurs populaires ont été écartés. Dans quelques mois, Moreno remettra sur la table une réforme fiscale destinée à satisfaire le FMI.
Une telle révolte n’est jamais exempte de faits de violences incontrôlés. Mises à sac, pillages, actes de vandalisme, dommages divers infligés aux biens meubles et immeubles, attaques et brutalités contre les personnes ont laissé une trace incandescente. Un chœur impressionnant s’élève. « Ceux qui agissent dans l’unique intention d’attaquer et de nuire sont des individus externes payés et organisés, a d’emblée accusé Moreno. Croyez-vous vraiment à une coïncidence lorsque Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pabón, ont voyagé au même moment, il y a quelques semaines, au Venezuela ? Le satrape Maduro et Correa ont activé leur plan de déstabilisation. » Sur les écrans de Teleamazonas, Guillermo Lasso vole au secours de son allié : « Il y a un seul responsable, Rafael Correa, qui, avec l’appui du Venezuela, veut déstabiliser l’Equateur. Nous ne devons pas le permettre. Il faut serrer les rangs aux côtés du gouvernement. » Alors qu’elle les encense au Venezuela, l’OEA condamne les actes de vandalisme en Equateur. Etroitement impliqués, sous les ordres de Washington, dans la persécution de Caracas, les gouvernements de l’Argentine, du Brésil, de la Colombie, du Salvador, du Guatemala, du Pérou et du Paraguay manifestent leur rejet catégorique de… « toute tentative de déstabilisation des régimes démocratiques légitimement constitués ». Il faut oser. Mais le comble du ridicule n’est pas encore atteint. Pour montrer qu’il existe, l’ « autoproclamé » vénézuélien Juan Guaido, bien que dépourvu de tout pouvoir, ose un désopilant : « Nous sommes en train d’essayer de localiser Rafael Correa, au cas où il serait encore au Venezuela. »
« Le “correisme” avait pris le contrôle des mobilisations », assure pour sa part (12 octobre) l’ex-président de la Conaie Salvador Quispe. A qui veut l’entendre, la réactionnaire députée de PK Lourdes Tibán raconte qu’elle a dû affronter Jaime Vargas, qui entendait radicaliser le mouvement, et dénonce qu’un secteur de la Conaie s’est laissé contaminer par le « correisme » : « Quand les indigènes ont-ils fait du vandalisme ? Jamais ! Le mouvement indigène est sorti pour faire tomber un décret, pas le gouvernement, car si nous renversions le gouvernement, ceux qui applaudiraient et célébreraient seraient les partisans de Correa, un gouvernement corrompu contre lequel je me suis battu [16]. »
La Conaie n’a ni attendu ni eu besoin de Correa pour déterminer ses méthodes parfois radicales d’opposition aux pouvoirs ! Dans l’ouvrage Estallido, publié après les événements d’octobre, les auteurs, parmi lesquels Leonidas Iza, consacrent un chapitre entier à l’utilisation de la violence dans la lutte populaire [17]. Ce qui, pas plus que les « correistes », ne fait d’eux les responsables ou les instigateurs des débordements d’octobre, dont les auteurs demeurent jusqu’à preuve du contraire inconnus…
Dans ce débat fumeux, ne manque plus que… Yaku Pérez. Lequel précise lui aussi qu’il ne s’agit ni « de déstabiliser le régime » ni de laisser l’action être « récupérée par les correistes ». Malgré sa participation sporadique et sa modération, Pérez sera ultérieurement mis en cause par le député Fabricio Villamar (CREO) pour avoir occupé l‘Assemblée nationale, le 8 octobre, avec des manifestants. A la manière d’un Bill Clinton prétendant avoir certes fumé de la marijuana, « mais sans avaler la fumée », Pérez expliquera qu’il a seulement foulé « la cour du bâtiment » sans pénétrer dans l’Assemblée [18]. Ce qui lui permettra un peu plus tard, totalement dédouané, de considérer « irréfutable » la présence d’infiltrés « correistes » et de considérer que c’est à la justice de déterminer qui sont les responsables des violences. Si elle conclut, ajoutera-t-il, que ce sont ses « compañeros » Jaime Vargas et Leonidas Iza, « ils seront jugés selon ce que détermine le Code pénal [19] ». Le genre de déclaration solidaire que ses « frères indigènes » n’oublieront pas…
Au terme du soulèvement, la répression s’abat. Très sélective. La justice poursuit Vargas et Iza (sans conséquences pénales jusqu’à présent). Fidèle à Correa, Paola Pabón, préfète de la province de Pichincha, sera arrêtée le 14 de octobre : « Ils sont entrés dans ma maison à l’aube et ont défoncé la porte alors que je dormais. » Dirigeants de la « révolution citoyenne », Virgilio Hernández et Christian González subissent le même sort, accusés de « rébellion ». Menacé de détention préventive, l’ex-ministre Ricardo Patiño choisit de s’exiler au Mexique. Haineux, les médias appuient et encouragent la chasse aux sorcières. « Le pays veut savoir, au terme du procès, si toute l’angoisse et les dommages causés en octobre dernier étaient dirigés [au sens d’organisés par…], fulmine le 29 août l’éditorial d’El Universo ; et si oui, que cela soit puni avec la sanction adéquate. »
Accointances et connivence sont les deux mamelles de la réaction. Le 18 septembre, Moreno rend hommage à l’un de ses alliés : « Aujourd’hui, j’ai visité les installations du journal @eluniversocom. Je félicite ses travailleurs, ses journalistes et ses dirigeants pour leurs 99 ans de vie institutionnelle » [20]. A charge pour El Universo et ses compadres médiatiques de renvoyer amplement l’ascenseur en torpillant Arauz lors de la campagne électorale qui va débuter.
Parcours du combattant pour Arauz (et Correa)
En 2018, avec l’aide du Conseil national électoral (CNE), Moreno a confisqué Alianza País aux partisans et représentants du « socialisme du XXIe siècle ». Dans le contexte de sa campagne pour le « non » au référendum de février 2018, Correa annonce la création d’une nouvelle formation politique, le Parti de la révolution citoyenne. Pour des « problèmes de procédure », le CNE refuse de l’enregistrer. Qu’à cela ne tienne, ce sera le Mouvement révolution alfariste (MRA) – du nom d’Eloy Alfaro, principal dirigeant de l’Equateur de 1895 à 1911, durant la Révolution libérale, sauvagement assassiné en 1912. Le CNE ne manque pas d’imagination : il refuse de légaliser le parti au prétexte qu’Alfaro était « libéral » et que le MRA est « anti-néolibéral » ! En décembre 2018, ce qui demeure la plus grande force politique d’Equateur réussit finalement à passer un accord avec un parti déjà existant, Fuerza Compromiso Social (FCS). C’est grâce à cette plateforme qu’il remporte le 24 mars 2019 les Préfectures de Pichincha et de Manabí.
Les regards se tournent déjà vers la présidentielle de février 2021. Interdit de réélection à la présidence par le référendum de 2018, Correa envisage une formule similaire à celle qui a réussi en Argentine : pour assurer la victoire de son camp, Cristina Fernández de Kirchner a choisi de postuler à la vice-présidence sur le ticket d’Alberto Fernández – finalement avec succès. Un premier mur de contention est dressé immédiatement. Le 7 avril, pour « corruption de fonctionnaire » dans l’affaire dite des « pots-de-vin 2012-2016 », la Cour nationale de justice requiert une peine de huit années de prison contre Correa. Objectif non dissimulé : rendre la sentence effective avant le 17 septembre 2020 – date de l’inscription des candidatures aux élections de 2021.
Eliminer l’homme va de pair avec la nécessité de détruire son mouvement : âme damnée de Moreno et de la ministre de l’Intérieur María Paula Romo, le contrôleur général Pablo Celi destitue la présidente du Conseil national électoral Diana Atamaint ainsi que deux de ses conseillers parce qu’ils refusent d’ôter son statut juridique à Fuerza Compromiso Social. Le 15 septembre, deux jours avant la période d’enregistrement des candidats, FCS se voit ainsi éliminé du registre des organisations politiques habilitées à se présenter [21]. Dans le sillage de Celi, le secrétaire général de la présidence, Juan Sebastián Roldán, pratique ouvertement l’intimidation en prévenant qu’être candidat à la députation en représentation d’une formation dirigée par Correa « entraîne un risque considérable » : « La justice va poser ses yeux sur ceux qui ne se sont pas enfuis ou qui ne sont pas encore condamnés. »
Commence (ou se poursuit) une bataille surréaliste (pour ne pas dire un mauvais feuilleton). Estimant que Celi a outrepassé ses fonctions, les juges du Tribunal contentieux électoral (TCE) réintègrent les trois fonctionnaires sanctionnés du CNE. Pour leur part, les militants de la « révolution citoyenne » obtiennent in extremis l’asile d’une organisation politique appelée Centre démocratique, qui va leur permettre d’enregistrer leurs candidats. Ironiquement surnommé par la presse « le parfait inconnu », Andrés Arauz officialise son aspiration à la présidence. Risquant d’être arrêté dès qu’il posera un pied sur le sol national, Correa postule à la vice-présidence depuis la Belgique, via Internet. Candidature rejetée par le CNE, car non effectuée « en personne et sur place » – malgré la présence de sa sœur Pierina Correa, dont il a fait sa représentante légale. Le 7 septembre, le suspens prend définitivement fin. Une cour de cassation de la Cour nationale de justice (CNJ) rejette le dernier appel déposé par Correa et confirme sa condamnation à huit ans de prison. S’y ajoutent 21 ans de proscription politique. Record battu pour la Justice équatorienne ! Le procès a été conclu et la sentence émise en moins de douze mois. D’autres procédures de cassation ont duré jusqu’à vingt ans (comme celle engagée contre l’ex-président Jamil Mahuad pour détournement de fonds).
En catastrophe, et malgré les obstacles donnant lieu à des manifestations pacifiques devant le TCE, le journaliste Carlos Rabascall remplace Correa dans le rôle d’aspirant à la vice-présidence. Le Centre démocratique se fond dans une vaste coalition d’organisations sociales, paysannes et indigènes, l’Union pour l’espérance (UNES) [22].
En novembre 2020, à Chimoré, lors du retour triomphal d’Evo Morales dans son pays, Arauz partage la tribune avec lui et l’ex-vice-président bolivien Álvaro García Linera. On le voit également aux côtés du nouveau chef de l’Etat Luis Arce. Il jouit de l’appui implicite et explicite de la gauche continentale.
En Equateur, où il progresse dans les sondages, la peur engendre un redoublement de l’agressivité. Que ce soit dans ses spots télévisés ou lors de ses interventions de terrain, toute la campagne d’Arauz revendique l’héritage de Correa. Partout, dans les villes, les villages, le candidat exhibe une figurine en carton, à l’échelle, de son « mentor ». Les droites poussent des cris d’orfraie. Comment peut-on exhiber ainsi un criminel, condamné par la justice, en cavale à l’étranger ? Dans le cadre de la campagne officielle, le TSE interdit à Arauz l’utilisation de tout portrait de Correa.
Dans la lutte avec ses confrères pour savoir qui gagnera le prix du plus putassier, El Universo se distingue particulièrement. « Notre Mugabe » titre l’un de ses éditorialistes, passablement paniqué, le 30 janvier 2021 : « Etonnamment, notre Mugabe continue d’avoir une grande acceptation populaire et il ne serait pas du tout étrange que son candidat gagne les prochaines élections. Les Européens et les Nord-Américains, qui ont créé les sciences, les plus belles œuvres d’art et les avancées technologiques les plus importantes, ont également créé la démocratie, comme mécanisme permettant de contrôler les dirigeants et de limiter leurs abus. Mais en Equateur, comme au Zimbabwe, nous utilisons la démocratie pour récompenser les corrompus et élire ceux qui sont assurés d’abuser de leur pouvoir et de nous appauvrir. C’est inexplicable. »
Bonjour et « bienvenido » : voici que vient à la rescousse le très droitier hebdomadaire colombien Semana. Juste avant le premier tour, dans son édition du 31 janvier au 7 février, celui-ci fait sa « une » sur une révélation explosive : Arauz et l’UNES ont reçu 80 000 dollars de l’Armée de libération nationale (ELN), une guérilla « terroriste » colombienne, pour financer leur campagne électorale. L’information vient d’une source particulièrement sûre : l’ordinateur trouvé près du corps d’un commandant guérillero, Andrés Vanegas, alias « Uriel », abattu en Colombie le 25 octobre 2020. « Nous souhaitons que le président Iván Duque et son gouvernement aient la gentillesse de nous fournir toutes les informations, réagit immédiatement Moreno ; selon les informations fournies par le magazine Semana, tous les dossiers ne sont pas encore ouverts. Cela ne manque pas de me faire frémir. » Il n’a pas osé employer le verbe « jouir », mais il y a sans doute pensé.
Dans le registre de l’hypocrisie absolue, Moreno fait du « Moreno de top niveau ». Alors que lui-même occupait la vice-présidence, Correa a subi le même type de campagne en 2008, après que, le 1er mars, un commando de l’armée colombienne ait tué Raúl Reyes, le numéro deux et « ministre des affaires étrangères » des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Un scandale de dimension internationale éclata lorsque trois ordinateurs, deux disques durs et trois clés USB « récupérés près du corps du guérillero et lui appartenant » révélèrent leurs « secrets ». Comme le diffusera abondamment le gouvernement colombien d’Álvaro Uribe (« père spirituel » de l’actuel président Iván Duque), relayé par la quasi totalité des médias internationaux, les enquêteurs trouvèrent dans le matériel informatique « des milliers de courriers électroniques » révélant l’« alliance armée entre les FARC et le gouvernement vénézuélien de Hugo Chávez »,ainsi que les liens politiques et économiques (lors de sa campagne électorale) entre Correa et la guérilla [23].
Le 18 mai 2011, mettant à mal la basse politique de Bogotá (et de Washington) contre Caracas et Quito, les neuf juges de la Cour suprême de justice (CSJ) de Colombie déclareront, par la voix de leur président Camilo Tarquino, que les informations obtenues à partir du matériel informatique de Reyes, dans lequel ne figurait aucun courrier électronique, étaient « nulles et illégales ».
Fille illégitime du CPCCS-transitoire, la procureure générale Diana Salazar – la « Procureure 10/20 » ! – sollicite immédiatement de la Justice colombienne les dossiers et documents évoqués par Semana. En urgence absolue, le procureur général colombien Francisco Barbosa, ami personnel de Donald Trump et proche d’Uribe, fait le voyage à Quito. Son « rapport complet » est désormais entre de bonnes mains. Salazar a déjà fait tomber le vice-président Jorge Glas. Le 25 février, avec les félicitations du Secrétaire d’Etat Antony Blinken, elle va recevoir l’International Anticorruption Champions Award, distinction octroyée par le gouvernement des Etats-Unis [24]. Le lendemain – on est alors entre les deux tours –, Yaku Pérez, révèle, s’il en était besoin, sa véritable nature : « Ce que le procureur général colombien est venu livrer à son homologue équatorienne, ce ne sont pas des indices graves, ce sont des certitudes. Et cela signifie que si la candidature de M. Arauz ne tombe pas avant [le deuxième tour des] élections, avant avril, elle tombera plus tard pour avoir reçu de l’argent illicite de la narco-politique. [25] »


- Procureur général de Colombie Francisco Barbosa avec le président autoproclamé Vénézuélien Juan Guaido.
Une candidature contestée
« Iza, Iza, Iza ! Comienza la paliza ! » (« Iza, Iza, la raclée va commencer ! »). Quechua, président du Mouvement indigène et paysan de Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza a été avec Jaime Vargas, achuar d’Amazonie et président de la Conaie, le leader le plus en pointe du soulèvement d’octobre 2019. Au terme de la crise dont elle sort renforcée, la Conaie annonce son intention de présenter un candidat à la présidentielle de 2021.
Président d’Ecuarunari de 2013 à 2019, puis élu préfet d’azuay, fonction qu’il va « planter » rapidement pour postuler à la magistrature suprême, Yaku Pérez (de même que les autorités élues de Pachakutik) n’a eu qu’un rôle secondaire lors de la rébellion populaire. Ce relatif retrait, son appel à voter Lasso en 2017, son alignement sur Washington face aux événements régionaux (Nicaragua, Cuba, Venezuela), son soutien aux renversements de Dilma Rousseff puis d’Evo Morales ne lui valent pas, au sein même du mouvement indigène, que des regards amicaux.
Dans la perspective de l’élection, la Conaie pousse Vargas et Iza. Lors d’une réunion virtuelle, sans leur présence ni celle des dirigeants de la Confédération, PK fait de Pérez son candidat « de consensus ». Devant ce coup de force, le mouvement indigène se fracture. La Conaie considère nulles et non avenues les résolutions de son bras politique, Pachakutik : « Le compañero Yaku doit terminer le mandat que lui ont donné la province, le peuple d’Amuay. Il y a une offre, un plan de gouvernement, s’il s’en va c’est un risque de perdre une préfecture de PK. » Un communiqué réclame que la désignation des candidats à la présidence et à l’Assemblée « se réalise en coordination et avec une participation active, avec voix et vote, de la structure d’organisation du mouvement indigène. »
Le 12 août 2020, la Conaie convoque une réunion avec les pré-candidats. Le comité exécutif de PK et Yaku Pérez s’abstiennent d’y assister. Malgré sa popularité et son poids, PK refuse à Vargas la responsabilité de tête de liste pour les législatives. Tout comme Iza, Vargas retire sa candidature à quelque fonction que ce soit. La fracture ne fait s’amplifier quand tous deux, invités, assistent en Bolivie au retour d’Evo Morales et y croisent… Andrés Arauz, sans manifester à son égard une quelconque animosité.
Autre problème épineux… Dans un premier temps, PK choisit Larissa Marangoni comme candidate à la vice-présidence pour accompagner Carlos « Yaku » Pérez. Le choix provoque des remous. Originaire de Guayaquil, Marangoni a, par le passé, prôné la privatisation de l’IESS (la sécurité sociale) et de l’entreprise publique d’électricité (CNEL), la cession des Galápagos à un autre pays et a estimé que les dirigeants indigènes ayant participé à la révolte d’octobre 2019 auraient dû être emprisonnés. Twitter, Facebook et les réseaux sociaux passent en surchauffe. Yaku Pérez se fend d’un tweet exprimant sa « tristesse » lorsque, sous la pression, Marangoni choisit de renoncer. La remplace une scientifique, propriétaire d’une entreprise spécialisée dans la biotechnologie de l’aquaculture (Concepto Azul), Virna Cedeño. Laquelle, simple Equatorienne, disparaît totalement pendant la campagne (et même après), totalement évincée du devant de la scène et même des coulisses par la compagne franco-brésilienne de Pérez, Manuela Picq. Ce qui en trouble plus d’un, qu’il soit adversaire, sympathisant ou militant…

- Yaku Pérez et Manuela Picq
La campagne
Renversé en 2005 par la « Rebelión de los Forajidos » (rébellion des hors-la-loi), Lucio Gutiérrez promet Dieu (qu’il réintroduira dans la Constitution), du pain (pour l’économie) et le fouet (pour muscler la justice). La Gauche démocratique de Xavier Hervas affiche un programme centriste, pour le moins dans les intentions. Seule femme candidate, Ximena Peña se présente sous les couleurs d’Alianza País, devenu le parti de Lenín Moreno, et donc inaudible pour qui que ce soit. Possesseur de plusieurs comptes dans les paradis fiscaux, Lasso (CREO-PSC) ne surprend personne avec son agenda, néolibéral – Washington, FMI, marchands, flexibilité du travail, baisse des impôts pour les financiers et les banquiers.
Yaku Pérez propose un programme « Minka por la vida » [26] destiné à capter le vote des jeunes et des communautés sensibles à la cause sociale et écologiste. Parmi les priorités se distinguent le financement de 500 000 petites et moyennes exploitations de production agricole ou la convocation d’une consultation populaire « pour déclarer l’Equateur libre de toute exploitation extractive dans les zones de recharge hydrique ». Un audit de la dette va de pair avec une renégociation des contrats miniers. Toutefois quelques aspects du logiciel attirent l’attention. On laissera de côté, pour le folklore, l’idée extravagante d’exporter de l’eau en barils plutôt que du pétrole. Comme Moreno, Pérez veut la disparition du CPCCS – mais également du Conseil de la magistrature et du Tribunal contentieux électoral (à qui il fera bientôt appel pour tenter d’inverser le résultat de l’élection !) – et, comme Lasso, il veut réduire l’Etat – en diminuant de moitié le nombre des députés et en supprimant un certain nombre d’institutions publiques (non précisées). Le développement du tourisme vert et de l’artisanat prennent plus de place dans ses interventions que l’industrie, les services, la science ou l’éducation.
Trente milliards de dollars de la « crème équatorienne » dorment dans les paradis fiscaux : Pérez s’oppose à toute pression sur leurs propriétaires, mais demande gentiment à ces indélicats de rapatrier leur pactole en échange d’avantages fiscaux. Par la même occasion, l’impôt sur les sorties de capitaux sera éliminé (de sorte que ce qui éventuellement rentrera pourra ressortir sans difficultés). Rien de surprenant donc si, en début de campagne, Lasso en personne a pu déclarer : « Si Yaku Pérez passe au second tour, soyez en sûrs, je lui apporte dès aujourd’hui mon soutien. » Rien de surprenant non plus quand, depuis la Conaie, Leonidas Iza s’insurge : « J’ai été absolument clair sur les propositions avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord, défendus par certains secteurs qui sont autour de Yaku Pérez. Il y a des gens proches de CREO et à droite qui sont sûrement dans le cercle de Yaku... [27]. »
Porteur d’un projet d’« économie sociale » articulé autour du progrès technologique et d’un développement productif diversifié, le tout sous l’égide de l’Etat, Arauz entend « déclarer une urgence nationale pour l’irrigation et l’eau » et mettre en place un ministère de l’agriculture familiale, de la paysannerie et de la souveraineté alimentaire disposant d’un budget adéquat. Il n’esquive pas le débat sur les activités minières. « L’agenda anti-extractiviste doit être un peu plus sophistiqué et détaillé car de nombreuses questions doivent être prises en compte, notamment l’industrialisation des mines et le développement des communautés voisines, déclare-t-il, en visite à New York, à la mi-février 2021. Nous ne pouvons pas avoir un agenda extractiviste néocolonial, mais peut-être pouvons-nous chercher un agenda pétrolier, minier et agricole qui prenne en compte les besoins des communautés et en fasse les acteurs principaux. » Au FMI, qu’il rencontre à cette occasion, Arauz fait savoir qu’il compte revoir les conditions léonines imposées au pays (ce que prévoit également Pérez). En matière de politique extérieure, souveraineté, multilatéralisme, intégration latino-américaine reviennent à l’ordre du jour, avec en priorité une reconstruction de l’Union des nations sud-américaines (Unasur) et un renforcement de la Communauté des Etats latino-américains et caraïbes (Celac).
On a beaucoup reproché à Correa, très influencé par la doctrine sociale de l’Eglise, ses positions rigides (et parfois même caricaturales) sur l’avortement. Celui-ci n’est autorisé en Equateur que lorsque la vie ou la santé de la mère est en danger ou si la grossesse est le résultat du viol d’une femme souffrant d’un handicap mental. Dans un pays conservateur, dont la population est à 80 % catholique, les candidats à la présidence, quelle que soit leur opinion personnelle, savent en la matière marcher sur des œufs.
Deux postulants – Xavier Hervas (GD) et Ximena Peña (AP) ont avancé la proposition très modeste de dépénaliser l’interruption de grossesse en cas de viol. Sur son compte twitter, et à destination de son public connecté – « écologiste, féministe et anti-patriarcal » – Yaku Pérez s’est chaudement félicité de l’autorisation de l’IVG votée en Argentine fin décembre 2020. Face à de potentiels électeurs, lesquels n’ont rien à voir avec ses « followers », il a fait beaucoup moins d’étincelles ! Il se déclare partisan, mais « à titre exceptionnel », de la légalisation de l’avortement thérapeutique « en cas de viol, de danger pour la santé de la mère [ce qui existe déjà] ou de malformation du fœtus [28] ». On a connu féministe autoproclamé plus audacieux.
Egalement interrogé, Arauz répond pragmatiquement, en ne fermant aucune porte : « J’ai ma position, qui répond à mon expérience de la vie, mais, en Equateur, ma position est de respecter la Constitution de la République. Je pense que dans certains cas, cela devrait être permis, mais le débat doit être promu par la société (...) par la mobilisation, notamment des femmes. Là-bas, en Argentine, nous avons eu des millions de femmes dans les rues, en Equateur, cela ne s’est pas encore produit [29]. »
Proche de l’Opus Dei, Lasso, qu’Arauz (sauf coup de théâtre) affrontera au second tour, a toujours été un féroce opposant à toute proposition de dépénalisation de l’avortement – y compris en cas de viol.
L’entre-deux tours
7 février 2021 : Arauz l’emporte devant Lasso et/ou Yaku Pérez. Par son score (plus de 19 %), ce dernier fait l’événement. Un grand leader serait-il né ? « Les presque 20 points gagnés par Yaku au premier tour reposent sur le rejet des politiques économiques de la “triple alliance” (Lenín, FMI et grands groupes économiques), analyse fort justement Alfredo Serrano, directeur du Centre latino-américain de géopolitique (Celag), le 12 février. Un rejet dont le mouvement indigène était le principal protagoniste. Ce n’est pas pour Yaku que le peuple a voté. La majorité de l’électorat aurait voté pour Yaku, Iza, Vargas, ou tout autre représentant de cette résistance manifestée de manière épique dans les rues face à l’ajustement néolibéral. Cet esprit indigène rebelle s’est transcendé, devenant un véritable sujet politique et électoral (…) On pourrait dire que Yaku est un candidat non progressiste qui a réussi à capter une partie du vote progressiste et indigène. » Plus brièvement, Leonidas Iza ne dit pas autre chose : « Ce n’est pas un appui au candidat, c’est un appui au soulèvement d’octobre ! »
Qui participera au second tour ? Dès le 8 février, où on l’annonce « éliminé de très peu, Yaku s’en prend à… tout le monde. « J’invite le candidat Pérez à rester calme, réagit Lasso, à ne pas se montrer si nerveux. » Dans n’importe quel pays, une si faible différence entre deux candidats rend parfaitement légitime la demande d’un recomptage en cas de doute ou d’anomalie avérée. Mais la réclamation prend une tournure étrange. On se croirait dans le camp de l’opposition, au… Venezuela (ou en 2019 en Bolivie). Quand le CNE confirme que Lasso le devance, Pérez hurle d’emblée à la fraude. Pourtant, Pachakutik ne conteste pas la victoire des 26 députés qu’il vient de faire élire, avec le même Conseil national électoral (CNE), devenant ainsi la deuxième force politique à l’Assemblée. Les « correistes » (Centre démocratique) sont arrivés en tête avec 51 représentants ; la Gauche démocratique en compte 17 ; le Parti social-chrétien (PSC), 18 ; CREO, 12.
Mais justement, s’insurge Pérez… « Comment est-il possible que la cinquième force politique du pays veuille déplacer la deuxième force ? Nous avons 26 membres de Pachakutik à l’Assemblée contre 12 de CREO ! » N’importe quel être doué de raison hausse immédiatement les épaules. A la présidentielle, c’est en alliance que CREO et le PSC, représentés par Lasso, ont pris l’avantage sur Pachakutik. Aux législatives, chacun s’est présenté pour son compte. Qu’on additionne leurs résultats (18 + 12 = 30), rien de surprenant à ce qu’ils devancent PK (26).
Lors de sa première conférence de presse, Pérez prétend que ses voix ont été détournées vers Hervas (GD). Puis il annonce que, en fait, il a gagné le premier tour. Dénonce le grand complot monté par Correa et Lasso. Accuse le Conseil national électoral (CNE) de complicité. Curieux, non ? La présidente de l’organisme s’appelle Diana Atamaint. Après avoir travaillé à la Banque mondiale, elle a été élue en 2006 députée de Morona Santiago en représentation de… Pachakutik. Pendant un mouvement de contestation de la communauté shuar, en 2009, elle a représenté les manifestants indigènes lors du dialogue, musclé, avec le gouvernement de Correa. Elle a enfin été nommée membre du CNE par le fameux CPCCS-Transitoire voulu par Moreno. On peut éventuellement l’accuser d’incompétence ou d’incurie, sûrement pas de connivence avec l’ancien chef de l’Etat.
Peu importe. Yaku Pérez réclame l’ouverture des urnes dans sept provinces – Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Bolívar, Esmeraldas – où, prétend-il, des voix lui ont été volées. Il est reçu par le Contrôleur général Pablo Celi, à qui il dénonce la manipulation du système informatique du CNE. Il porte plainte en justice pour fraude électorale. Il remet à la Cour constitutionnelle (CC) une demande de mesures préventives pour qu’on suspende le scrutin...
Effroi à bord du bateau de la Grande alliance « Moreno, partis de droite, organisations patronales, banques, médias et discrets acteurs internationaux » : seule une alliance de tous les opposants peut permettre de battre Arauz au second tour. Cette guerre « interne » risque de tout faire capoter. Depuis plusieurs jours déjà, Hervas (GD) invite Pérez et Lasso à laisser de côté leurs intérêts personnels et à passer un « Pacte pour l’Equateur », faute de quoi serait ouvert « un sentier pour le retour du “correisme” ». Les médias sont tétanisés, incapables de prendre position pour l’un ou pour l’autre. Lasso représente la droite classique, qui leur sied parfaitement, mais Pérez aurait davantage de chances de battre Arauz, du fait d’un positionnement lui permettant de capter le mouvement indigène, une partie de la « gauche » et de la jeunesse.
Le 12 février a lieu à Quito, au siège du CNE, dans le Salon de la démocratie, une étonnante réunion. N’y sont présents que Lasso, Pérez, des membres du CNE, des observateurs internationaux et un représentant de l’OEA. Les quatorze autres partis ayant participé au scrutin ne sont pas conviés. Et surtout pas l’UNES, pourtant directement intéressée. Il s’agit d’évaluer toutes les options possibles et de se mettre d’accord, entre adversaires, mais aussi comparses, dans la plus stricte intimité. Lasso pourrait certes défendre mordicus sa seconde place, mais il se retrouve pris à son propre piège : en avril 2017, n’a-t-il pas lui même déclaré qu’il n’acceptait pas le résultat donnant la victoire à Moreno ? N’a-t-il pas déclaré à l’époque « dans le décompte des votes, il y a fraude », avant de demander le recomptage de 100 % des voix ? N’a-t-il pas convoqué ses partisans à manifester avant que la victoire de Moreno ne soit confirmée par le recomptage de 11,2 % des bulletins ? Effet boomerang. Yaku Pérez emprunte le chemin que Lasso lui même a balisé…
D’entrée, le candidat de PK met la barre très haut. Présentant quatre cas de procès-verbaux comportant des irrégularités, il exige que les voix soient recomptées dans… les 24 provinces du pays ! Dans la vie, d’une manière générale, la conviction peut être rationnelle ou irrationnelle. Aux objections qu’on lui présente, Pérez extrapole sur les quatre cas ainsi que sur « 15 % de procès verbaux qui ont posé problème au début du scrutin » et en déduit qu’ils équivalent à 1 500 000 voix. Lasso admet le droit légal, pour Yaku, de présenter des cas avec les preuves nécessaires pour mettre en doute certains résultats, mais, « s’il y a neuf ou dix cas, ce n’est pas suffisant pour invalider un processus », se permet-il de noter.
Six heures de conciliabules, ce 12 février ! Finalement, le CNE entérine l’accord qu’ont scellé entre eux les deux candidats : il procédera à un recomptage de 100 % des votes de la province de Guayas, qui comporte le plus d’électeurs, et de 50 % dans seize autres provinces – soit plus ou moins 6 millions de bulletins,45 % des suffrages exprimés. La présidente Atamaint précise que seuls les délégués des deux partis demandeurs participeront à ce processus de vérification, sans observateurs internationaux – à l’exception de l’OEA ! Laquelle se réjouit d’avance : membre de sa mission, Gerardo de Icaza exprime « sa reconnaissance » au CNE « pour avoir écouté les parties et les avoir reçues » dans le but de fournir « les garanties nécessaires et indispensables de certitude et de transparence ». Les commentaires émis à Washington expriment la même satisfaction.
Une énormité ! En se laissant imposer ce marchandage par deux candidats, en dehors de toute procédure légale, en écartant les quatorze autres participants au scrutin (dont celui qui a obtenu le plus de voix), en ignorant le Conseil consultatif des organisations politiques pour traiter une telle question, comme le stipule la loi, en se soumettant finalement à la décision de Pérez et de Lasso, le CNE a, comme eux, franchi une ligne rouge. « Nous ne permettrons aucune action qui, dans le cadre de la démocratie et du recomptage des votes, prétende affecter l’immense volonté du vote obtenu par l’alliance qui nous a permis un large triomphe populaire », clame le porte-parole de l’Union pour l’espérance. Lasso prend-il conscience de ce que les articles 136 et 138 du Code de la Démocratie ont été violés et qu’il se met dans une position délicate ? Dès le lendemain, il se rétracte. Dans un courrier, il demande au CNE de promulguer les résultats du premier tour, « sans préjudice des contestations qui seraient présentées conformément à la loi ». S’il confirme être d’accord avec un recomptage de 100 % des votes dans la Guayas, il estime nécessaire l’assentiment des autres candidats pour un recomptage à 50 % dans les seize autres provinces. « Si le CNE procède autrement, ajoute-t-il, ce ne sera pas seulement injuste, mais illégal et même criminel, car il sera présumé qu’un ou plusieurs crimes ont été commis et cela entraînera également la nullité du processus électoral. » Qu’il représente la droite n’y change rien : ce qu’il dit est parfaitement vrai.
Fin de l’histoire d’amour entre « anti-correistes ». Réuni en plénière, le CNE revient lui aussi sur sa décision, malgré le vote de sa présidente Atamaint. Se souvenant qu’il existe des règlements et des lois, l’un des membres ayant voté contre le recomptage déclare qu’il faut d’abord « proclamer les résultats du premier tour avant tout recours ».Pérez n’a que faire de la loi, Pérez s’emporte, Pérez insiste,Pérez accuse Lasso de trahison : « Nous demandons le respect des règles, parce que la parole ne peut pas être dévaluée, parce que les accords doivent être respectés, parce que la transparence est en jeu. » N’obtenant pas gain de cause, il annonce publiquement : « Ne rêvez pas qu’on soutiendra Lasso » au second tour, et ressasse à n’en plus finir sur « le pacte satanique » entre Correa, Lasso et Nebot(l’ex-maire de Guayaquil, leader du PSC).Il peut bientôt y rajouter la Cour constitutionnelle, qui rejette sa demande d’annulation des élections.
A l’appel de Pérez, le président d’Ecuarunari Carlos Sucuzhañay déclare l’organisation « en résistance » et annonce une « Marche pour la transparence et la démocratie », partant de Loja (à la frontière du Pérou) le 18 février pour arriver le 23 à Quito. La Fédération unitaire des travailleurs (FUT) annonce sa participation. En renforts, surgissent simultanément… le contrôleur Pablo Celi et la procureure générale Diana Salazar. A quelques heures d’une réunion du CNE destinée à examiner les recours déposés par Pachakutik, le Parquet et la Controlaría, annoncent leur intention de procéder à une saisie et à un examen du système informatique, avant le second tour du 11 avril, PK ayant porté plainte pour de supposées anomalies. Contribuant à la confusion et alimentant les doutes qui entourent les résultats, la démarche amène Arauz à dénoncer « une tentative de retarder ou pire de suspendre les élections ». D’autant que, par le plus grand des hasards, le Gouvernement de Moreno a retiré les forces de police qui protégeaient l’immeuble et les autorités du CNE.
Outre la réaction d’Arauz, la manœuvre provoque celles de Lasso et du CNE. Directeur juridique du Conseil, Enrique Vaca doit rappeler que, en vertu de l’article 16 du Code de la Démocratie, « aucune autorité extérieure à l’organisation électorale ne peut intervenir, directement ou indirectement, dans le cours des processus électoraux ». Dans un pays au bord de la crise institutionnelle, l’UNES annonce qu’elle porte plainte auprès du Tribunal contentieux électoral (TCE) contre Salazar et Celi pour « ingérence dans les élections ».
Le 23 février, escorté par les participants de la marche indigène arrivés très pacifiquement à Quito, Yaku Pérez utilise cette fois (et enfin !) la voie des recours légaux en remettant au CNE 16 086 procès-verbaux présentant « des anomalies ». Lesquels deviennent 20 000 quelques jours plus tard. D’après Pérez, deux ou trois voix lui ayant été volées dans chacun de ces bureaux de vote, cela devrait lui permettre de récupérer 180 000 voix. Au terme de son audit, le CNE émet un rapport qui ne demande un recomptage que dans trente-et-un bureaux de vote – dix procès-verbaux présentant des incohérences numériques, vingt-et-un des signatures manquantes. Ce qui, l’opération effectuée, ajoutera 612 voix supplémentaires au bilan du candidat.
Tandis qu’Ecuarunari menace de paralyser le pays et déclare « une grève générale », Pérez recourt au Tribunal contentieux électoral (TCE) à qui il demande un recomptage de 28 000 procès-verbaux – 8 000 de plus, tombés du ciel, que ceux présentés précédemment au CNE. « Si la TCE n’ouvre pas les urnes, lance-t-il, nous serons confrontés à une ratification de la fraude. Dans le Nouveau Testament, livre de Jean, chapitre 30, verset 5, il est dit : “La vérité vous rendra libres”. En ce moment, nous sommes les esclaves du CNE et la seule façon de nous libérer est de connaître la vérité [30]. » Une formulation messianique à souhait, mais quelque peu maladroite, voire imprudente, nous permettrons-nous de signaler (sans insinuation d’aucune sorte, juste par amusement). « Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres »est certes tirée du Nouveau Testament, mais c’est aussi la phrase gravée sur le mur de gauche du vaste hall d’entrée du quartier général de la CIA, à Langley (Virginie) !
Tout au long de sa campagne, Yaku Pérez s’est fait le chantre de la « transparence ». Il serait imprudent de prétendre qu’il en a lui-même abusé. Le 4 mars, photos à l’appui, le média électronique La Posta révèle une « réunion secrète » de Pérez et de Picq avec Ángel Torres, un juge du TCE. Le Tribunal doit rendre sa décision quelques jours plus tard sur le recours de PK. La rencontre a lieu tard le soir, dans un quartier aisé du nord de Quito, au domicile de Darwin Seraquive, ex-membre du CPCCS-transitoire cher à Moreno. Fort logiquement, l’article 12 du règlement intérieur du TCE stipule : « Les juges électoraux ne peuvent pas tenir de réunions avec les parties à la procédure, sauf dans le cas où ils y assistent conjointement et en justifiant à l’avance et par écrit la nécessité de la réunion. » La première réaction vient de l’organisme quand il informe qu’il « n’était pas au courant et qu’il n’a autorisé aucune réunion ». Pris en flagrant délit, Pérez et Torres se voient obligés de confirmer qu’ils se sont bel et bien croisés, « complètement par hasard », pendant une heure et demie précise Torres (ce qui est un peu long pour juste se serrer la main), au domicile de cette connaissance commune. La révélation fait scandale. L’image romantique de l’ « Indigène écolo » différent des politiciens traditionnels en sort passablement écornée.
Le 14 mars, après avoir écarté Torres, la plénière du TCE a rejeté à l’unanimité le recours de Pachakutik pour manque de fondement juridique. Dans leur analyse, les juges observent que n’ont pas été énoncés clairement les « vices, incorrections, incohérences » imputés aux décisions du CNE. Ils disent n’avoir pas plus identifié avec précision quels procès-verbaux n’ont pas été correctement pris en considération par le Conseil électoral et considèrent par ailleurs que les plaignants se sont limités à exprimer leur désaccord sans avoir les bases légales pour l’étayer. Un recomptage des voix, précise le TCE doit se faire « dans des cas spécifiques et exceptionnels, en évitant la manipulation excessive des votes et du scrutin ». Le dernier obstacle à l’organisation du second tour entre Arauz et Lasso vient de tomber.
Epilogue provisoire
Dans un sinistre climat de fin de règne, les collaborateurs et ministres de Moreno l’abandonnent les uns après les autres. Croyant sans doute se dédouaner d’une compromission de quatre années, Alianza País l’a destitué le 3 mars de la tête du parti. AP venait de se rendre compte qu’il n’a pas respecté le « plan de gouvernement » sur lequel il avait été élu ! Pour ajouter au ridicule, Moreno, qui se savait sous le coup d’une procédure disciplinaire, avait démissionné et annoncé quitter le parti deux jours auparavant. Démission refusée par la direction nationale pour pouvoir… l’expulser.
En prévision du premier tour, et pour rassembler son noyau dur, l’UNES s’est énormément appuyée sur l’image de Correa, dont Arauz a dit qu’il ferait l’un de ses conseillers. Dans la campagne qui s’annonce, l’ex-chef d’Etat sera quelque peu relégué au second plan : il s’agit désormais de rallier les anti-néolibéraux dont il n’est pas forcément la tasse de thé.
Le vote indigène se trouve au cœur de tous les enjeux. Sachant que cette « indianité » n’a souvent de sens que dans les discours des acteurs qui s’en saisissent. Le choix de « Yaku » comme candidat a fractionné le mouvement. Lorsque, avec Ecuarunari, il a convoqué la « marche pour la transparence et la démocratie », Leonidas Iza, depuis sa province, s’est contenté du programme minimum : il a bien pris la tête de quelques manifestations, mais a estimé : « A ce moment de la pandémie, pour être responsables, nous ne pouvons pas mobiliser jusqu’à Quito les communautés de Cotopaxi ». Vargas et la Conaie observent une prudence de bon aloi. A tel point que, le 27 février, Ecuarunari se livre à un véritable coup d’Etat à l’intérieur du mouvement : après avoir menacé de paralyser le pays et décidé de déclarer une grève générale, l’un de ses dirigeants, Gustavo Tenesaca, annonce que « la direction de la Conaie n’a plus la légitimité, car ayant terminé son mandat, et qu’elle n’est plus la porte-parole du mouvement indigène équatorien ».Fonction désormais exercée par Ecuarunari, « la fédération autochtone la plus importante du pays. »
Pour autant, la fameuse « marche pour la transparence et la démocratie » demeure limitée et n’atteint nullement l’ampleur espérée. Pas plus que la « grève générale » annoncée.
Très attendue, la décision de Yaku Prez est tombée le 18 mars : il laisse à ses électeurs leur liberté de vote pour le second tour. La Conaie, elle, ménage la chèvre et le chou. Le 9 mars, lors d’un conseil élargi auquel ne participait pas Pérez, elle s’est prononcée pour un « vote nul idéologique ». Bien que son coordinateur Marlon Santi se soit prononcé dans le même sens à titre personnel, PK doit encore se réunir pour définir s’il soutient cette option, susceptible, dans les rêves de certains « anti-correistes », de faire annuler l’élection. En effet, dans son article 147, le code électoral prévoit la nullité d’un scrutin si le nombre des votes nuls est supérieur à celui recueilli par tous les candidats en lice. Un scénario très peu probable. D’après les données du CNE, le maximum de « votes nuls » observé l’a été lors du ballotage de 1996 (11,3 %) et du premier tour de 2006 (11,8 %) [31]. Dans les faits, le « vote nul » au second tour favorise le candidat arrivé en tête au premier. Ce qui est d’ailleurs, sans doute, la motivation de certains dirigeants de la Conaie qui, pour ne pas raviver les conflits qui déchirent le mouvement en appuyant le « dauphin de Correa », utilisent à dessein cette stratégie.
Par ailleurs, et comme par le passé, rien ne dit que les consignes données par les leaders seront massivement écoutées. D’autant qu’elles sont passablement contradictoire. Au lendemain de la fumeuse négociation entre candidats du 12 février, Iza, réprobateur, avertissait : « Attention ! Une réunion pour compter les votes entre Yaku Pérez et Guillermo Lasso ne signifie pas un accord avec la droite. Ce serait illégitime et en dehors de toute décision organique de la Conaie et du Pachakutik. Notre combat est contre la droite, peu importe d’où elle vient. » Qui a oublié que, pendant les mobilisations d’octobre 2019, l’allié de Lasso, le leader du PSC Jaime Nebot, recommandait aux Amérindiens « de retourner dans leurs montagnes » ? Et il faudrait prendre le risque de laisser « le banquier » s’installer à Carondelet ?
A en croire (avec prudence) les premiers sondages, Arauz paraît le mieux placé pour l’emporter. Sauf manœuvre de dernière minute pour torpiller la démocratie…
Durant toute la polémique sur le résultat de l’élection, Yaku Pérez a insisté sur le caractère « pacifique » des manifestations qu’il mobilisait. En ce sens, son influence a été positive, il a été suivi. Il a même provoqué l’ironie de Jaime Vargas, leader pour quelque temps encore de la Conaie, lors du conseil élargi du 9 mars dernier : « Ils [Carlos Sucuzhañay, d’Ecuarunari, et Javier Aguavil, de la Conaie,] nous appellent à nous battre. Je leur ai dit : comment va être la résistance ? Si le CNE nous vole vraiment... ce sont des voleurs. Alors prenons les CNE dans toutes les provinces. C’est ce que j’ai dit. Et ils ont dit : non... Le candidat dit que c’est pacifique, avec des petites fleurs, avec des colombes blanches, je ne sais pas quoi... Ce n’est pas efficace ! Si nous devons bloquer, nous allons bloquer, prenons tous les CNE et faisons le décompte, et réclamons, et si non, brûlons toutes les urnes ! » Le plus raisonnable des deux paraît incontestablement être Pérez. Sauf que…
Dans son obsession de remettre en cause les décisions du CNE et du TCE, le candidat de PK s’est aussi tourné vers la Commission anti-corruption. Le 7 mars, dans un article intitulé « Pro País » (« Pour le pays ») publié par le quotidien de droite El Comercio, l’un des membres de cette Commission, l’ex-jésuite Simón Espinosa, qui apporte publiquement son appui à Lasso, a proprement dynamité les débats en faisant appel à l’armée. « Nous suggérons que la force publique protège nos droits d’élire et d’être élu sans tricherie. De cette façon, elle s’acquittera de son obligation de nous défendre sans demander la permission de quiconque, puisque nous sommes confrontés à une affaire grave. Elle peut le faire par le biais d’une déclaration constitutionnelle qui comprend les éléments suivants [32]… » Et de citer, entre autres demandes : une enquête immédiate sur le financement d’Arauz par des criminels ; le remplacement des membres du CNE par leurs suppléants ; l’annulation du premier tour des élections ; l’intervention du Bureau du Contrôleur Pablo Celi dans les systèmes informatiques du CNE ; l’intervention du ministère public dans les procédures et les faits qui ont provoqué une alarme sociale…
Cette fois, le masque tombe (et pas celui de la pandémie). Ce n’est plus le représentant d’une « deuxième gauche écolo » qui s’exprime, mais une espèce de « Juan Guaido » équatorien. Sans prendre aucune distance avec ce qu’implique un tel appel, Carlos Yaku Pérez Guartambel tweete immédiatement : « Simón Espinoza, membre de la Commission anti-corruption, souligne que les militaires des Forces armées doivent intervenir dans les urnes pour rendre claires les élections et ainsi éviter le retour du correisme ; son article souligne ce qui suit. »
Quelques jours plus tard, Bogotá s’invite à nouveau dans la campagne. Le 14 mars, la « doctora » Martha Mancera, vice-procureure générale de Colombie, débarque chez ses homologues de la « Fiscalía » équatorienne pour leur remettre un complément d’information permettant d’avancer dans l’enquête sur le financement de l’UNES par la guérilla colombienne. De son côté, Marlon Santi, pour Pachakutik, a annoncé que le mouvement ne reconnaîtra pas le président sorti des urnes.
Au moins, Andrés Arauz sait à quoi s’attendre. Si le deuxième tour a lieu dans des circonstances normales et s’il le remporte, il devra être aussi vaillant et vigilant que Nicolás Maduro au Venezuela, Luis Arce en Bolivie, Daniel Ortega au Nicaragua. Mais s’il s’impose, c’est aussi parce qu’une majorité d’électeurs équatoriens se seront prononcés pour lui. Ce qu’on appelle la démocratie.




