Christophe Ventura : Dans votre ouvrage, vous indiquez les montants exorbitants (actifs bancaires, investissements directs à l’étranger des multinationales, évasion fiscale, etc.) qui transitent par le système international des paradis fiscaux. Selon vous, « plus de la moitié du commerce international (...) passe par eux ». Mais, au fond, qu’est-ce qu’un paradis fiscal ?
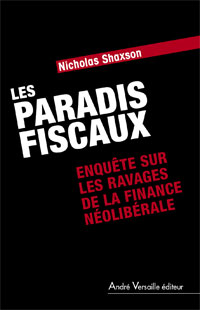
Nicholas Shaxson : On peut expliquer facilement ce qu’est un paradis fiscal avec deux mots : « échapper à » et « ailleurs ».
Les paradis fiscaux permettent d’échapper à l’impôt, certes, mais aussi aux lois pénales, à la régulation financière, aux obligations de transparence, etc. En un mot, aux responsabilités civiques et sociales. Ils exemptent les riches et les entreprises des contraintes, risques et obligations que la démocratie exige de chacun d’entre nous. La fiscalité n’est qu’un aspect de la question.
Le mot « ailleurs » est également crucial. Pour échapper aux responsabilités, il faut mettre son argent (son argent personnel ou celui de sa société) ailleurs. D’où le mot « off-shore », littéralement, en anglais : « hors du pays ». Ainsi, par exemple, la législation des Bahamas sera conçue pour attirer l’argent, non pas des habitants de l’archipel, mais des ressortissants étrangers.
CV : Quelle est leur fonction dans l’architecture de la finance internationale ?
NS : Les paradis fiscaux servent plusieurs objectifs. Leurs thuriféraires disent qu’ils permettent de remédier aux « insuffisances » du système financier international : grâce à eux, les capitaux se déplacent plus vite dans l’économie et rencontrent moins d’obstacles. Une image souvent utilisée est celle des grains de sable dans la machine : les paradis fiscaux fournissent l’huile qui lubrifie le moteur. Mais si l’on y regarde de plus près, l’on a une tout autre perspective. Quels sont ces « obstacles » qui sont supposés ralentir la finance mondiale et la rendre moins « efficiente » ? Ce sont les impôts, la régulation financière et les obligations de transparence – toutes choses qui ont une bonne raison d’exister ! On ne voit pas très bien, par exemple, en quoi le secret bancaire est « efficient » : il est peut-être bien pratique pour des personnes privées, mais il nuit au système dans son ensemble.
CV : Vous décrivez l’un des mécanismes auquel ont recours les multinationales : la « manipulation des prix de transfert ». De quoi s’agit-il ?
NS : Les prix de transfert sont un dispositif utilisé par les multinationales pour réduire le montant de leurs impôts. En gros, ce dispositif permet de localiser les profits de la société dans un paradis fiscal – où ils ne sont pas imposés –, et les coûts dans un Etat à forte fiscalité – où ils sont déductibles des impôts. Comment la multinationale procède-t-elle ? En jouant sur le prix des biens et des services que se facturent ses filiales. Prenons par exemple le cas d’une machine construite en France et vendue en l’Equateur via les Bermudes. Les coûts de production s’élèvent à 1000 dollars pour la filiale française ; le prix de vente en Equateur est de 2000 dollars. La filiale des Bermudes paie à la filiale française 1001 dollars pour la machine, qu’elle facture ensuite à la filiale équatorienne 1998 dollars. La filiale française réalise donc 1 dollar de profit (1001 – 1000 = 1), la filiale équatorienne 2 dollars (2000 – 1998 = 2), ce qui génère très peu de recettes fiscales tant pour l’Etat français que l’Etat équatorien. La filiale des Bermudes réalise quant à elle un profit de 997 dollars (1998 – 1001 = 997), qui n’est pas imposé. Hey presto ! Voilà comment a disparu une note d’impôt salée ! La réalité est bien sûr plus complexe, mais l’idée de base est là.
CV : Qu’est-ce que l’Offshore Magic Circle ?
NS : C’est le nom que s’est donné le petit groupe de cabinets juridiques qui dominent le secteur de la finance « off-shore ». Ils ont des bureaux dans de nombreux paradis fiscaux à travers le monde et sont passés maîtres dans l’art d’élaborer des montages financiers transfrontaliers, si fréquents aujourd’hui.
CV : Vous analysez la géographie politique des paradis fiscaux à l’échelle internationale et introduisez le lecteur aux différents groupes de « juridictions du secret ». Selon vous, il existe une « toile d’araignée » formée par trois cercles dont les plus importants et les plus agressifs gravitent autour de la City de Londres. Vous développez l’idée que le système des paradis fiscaux aurait une filiation avec l’histoire coloniale britannique, mais aussi française. De quoi s’agit-il ? Comment fonctionne ce nouvel empire de la finance ? Quel est le rôle actuel de la City de Londres dans le monde « off-shore » ?
NS : La Grande-Bretagne est au centre d’un réseau de paradis fiscaux qui alimente en capitaux la City de Londres et lui procure un gigantesque volume d’affaires. Le premier cercle de la toile est constitué de ce qu’on appelle les dépendances de la Couronne – Jersey, Guernesey et l’île de Man –, dont l’essentiel de l’activité se fait avec les pays d’Europe, d’Afrique, d’ex-URSS et du Moyen-Orient. Le deuxième cercle regroupe les territoires britanniques d’outre-mer, dont les îles Caïmans et les Bermudes, tournés surtout vers l’Amérique du Nord et du Sud. Ces entités (dépendances de la Couronne et territoires d’outre-mer) sont en partie britanniques, en partie autonomes : la Grande-Bretagne prend en charge leur défense, s’assure de leur « bonne gouvernance », et les gouverneurs sont nommés par la reine ; leur politique intérieure est en revanche indépendante. Au-delà de ces deux cercles, d’autres paradis fiscaux entretiennent des relations étroites avec la City de Londres, mais ils ont rompu tout lien institutionnel avec l’ancienne métropole coloniale – Hong-Kong par exemple.
Ce réseau de paradis fiscaux enveloppe la planète : chaque maillon « capture » les capitaux qui transitent dans sa sphère géographique et les achemine jusqu’à la City.
CV : Et celui des Etats-Unis ?
NS : Les Etats-Unis, notamment depuis les années 1970, ont sciemment adopté une législation qui assure aux fonds étrangers le secret bancaire et divers avantages fiscaux ; cela a permis d’attirer dans le pays quelques milliers de milliards de dollars de capitaux flottants en provenance de l’étranger. Certaines infrastructures « off-shore » existent au niveau de tel ou tel Etat, mais les plus importantes sont directement disponibles au niveau fédéral. Les Etats-Unis disposent également d’un petit réseau de satellites, tels le Panama ou les îles Vierges américaines, mais ce réseau est sans commune mesure avec la toile d’araignée britannique.
CV : Plongeant le lecteur dans l’histoire de l’évasion financière et fiscale, vous indiquez que le « vrai Big-Bang » a eu lieu à la fin des années 1950 avec l’émergence des eurodollars – les dollars détenus en dehors des Etats-Unis – et de l’Euromarket. Pouvez-vous nous en dire plus ?
NS : C’est une longue histoire, fort passionnante. En résumé, la City de Londres a offert aux banques un nouvel environnement non régulé, qui leur a permis dès les années 1950 de contourner la réglementation financière stricte mise en place au niveau national. En définitive, grâce à ce terrain de jeu « off-shore », Wall Street a pu croître de façon extraordinaire et retrouver toute sa puissance politique : elle a fait mainmise sur l’appareil d’Etat aux Etats-Unis et convaincu le législateur que la seule voie à suivre était celle prise par Londres.
CV : Vous proposez d’affronter le « système off-shore » et formulez pour ce faire plusieurs recommandations précises. Elles concernent les pays occidentaux (notamment le Royaume-Uni) comme ceux du Sud, le thème des réformes fiscales ou celui de la lutte contre la corruption. Que pourrait être, selon vous, une finance régulée ?
NS : Le système de Bretton-Woods, en place pendant les vingt-cinq années qui ont suivi la seconde guerre mondiale, nous fournit le meilleur exemple d’une finance bien régulée : de nombreux pays avaient instauré un contrôle des capitaux et un contrôle des changes ; les échanges financiers et la spéculation internationale étaient sévèrement encadrés ; le taux marginal de l’impôt sur le revenu était très élevé. Certains aujourd’hui considèrent cette période comme l’âge d’or du capitalisme : le commerce était libre (relativement), mais pas la finance ; il y avait une forte croissance économique, peu de crises financières, et les inégalités se réduisaient. Il est intéressant de noter que, tout récemment, le FMI a estimé que le contrôle des capitaux n’était peut-être pas une si mauvaise idée que ça…
CV : Que peut faire un pays comme la France ou l’Union européenne pour lutter efficacement contre les effets nocifs de la finance « off-shore » ?
NS : Il n’y a pas de recette miracle. La première chose à faire est de bien comprendre le rôle de la finance « off-shore » dans l’économie mondiale. Il convient de s’en faire une nouvelle idée. Puis il faut prendre toute une série de mesures ciblées – j’en décris certaines dans mon livre. Il faut par exemple établir un régime où les multinationales sont imposées en fonction de leur activité économique réelle plutôt qu’en fonction de leur forme juridique artificielle et compliquée : dans un tel régime, leur activité dans les paradis fiscaux ne serait pas prise en compte. Si les multinationales se retirent des paradis fiscaux, ceux-ci perdront une grande part des protections politiques dont ils bénéficient depuis des années.
CV : La construction européenne, dont deux principes fondamentaux sont « la libre circulation des capitaux » et « la concurrence libre et non faussée », n’a-t-elle pas favorisé la concurrence fiscale et par là même la constitution de nouveaux paradis fiscaux à l’intérieur même de ses frontières (le Luxembourg, les Pays-bas, l’Irlande, etc.) à côté des paradis fiscaux « traditionnels » comme la Suisse ?
NS : Absolument. Tout le monde sait que la Suisse est un paradis fiscal, mais il y en a d’autres en Europe : le Luxembourg, notamment, et bien sûr le Royaume-Uni. L’Autriche, les Pays-Bas et l’Irlande jouent aussi un rôle important. A chaque fois que l’Union européenne tente de s’attaquer au problème, elle se heurte à des obstacles politiques – et ce, depuis le début.
CV : La lutte contre les paradis fiscaux n’est-elle pas perdue d’avance : les pays émergents tels que le Chine, l’Inde et d’autres ne vont-ils pas aussi chercher à profiter des facilités de la finance « off-shore » ?
NS : Les paradis fiscaux ont été voulus par les élites fortunées des différents pays de la planète. Ils causent sans doute bien davantage de dégâts dans les pays en développement que dans les pays riches de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Et oui, c’est vrai : les élites chinoises soutiennent fermement Hong Kong (et son proche associé : les îles Vierges britanniques), en dépit des conséquences désastreuses pour le reste de la population du pays.
CV : Dans vos conclusions, vous vous adressez également aux médias. Quel est votre message aux journalistes et experts ?
NS : Un consensus est parvenu à s’imposer. Il stipule que le système est « efficient » et que les paradis fiscaux sont une bonne chose. Commençons par remettre en cause ce postulat. Le sujet est souvent si complexe que, pour expliquer comment les choses fonctionnent, les journalistes ont recours aux « experts » – la plupart du temps, des professionnels des « Big Four », les quatre grands cabinets d’audit. Le problème, c’est que ces cabinets d’audit font leur chiffre d’affaires en aidant leurs clients à échapper à l’impôt et à leurs autres obligations. Leur point de vue est donc biaisé en faveur du système. A chaque fois que les journalistes font appel à eux, leur vision du monde pernicieuse se diffuse auprès de l’opinion et s’incruste davantage dans les consciences.
CV : Voyez-vous une responsabilité imputable aux places « off-shore » dans les déboires de la zone euro, du système bancaire européen et de la Grèce ?
NS : Ceux qui, dans les paradis fiscaux, font les lois sont toujours séparés de ceux qui ont à en subir les conséquences. Il n’y a jamais de véritable consultation démocratique quand ces lois sont adoptées. Le problème est que ceci n’est pas seulement un acte délibéré. Les choses vont plus loin. C’est l’essence même des paradis fiscaux. Ces lois sont faites par des initiés pour des initiés : personne ne rend de comptes à personne, au contraire de ce qu’exige la démocratie. Les paradis fiscaux sont des machines législatives à usage privé, quasiment des cabinets secrets. Les conclusions à tirer de la dernière crise financière, comme de la prochaine, devraient être plutôt claires.
Entretien traduit par Emmanuel Fourmont, traducteur de l’ouvrage.
Les Paradis fiscaux : Enquête sur les ravages de la finance néolibérale, de Nicholas Shaxson, aux éditions André Versaille, Bruxelles, avril 2012, 448 pages, 19.90 euros.
 Lecture .
Lecture .

